+++Par Adji Fatim Diop+++
Dakar, 18 jan (APS)– Elles sont de plus en plus nombreuses ces filles qui mettent le voile pour se couvrir la tête, notamment en milieu scolaire, où cette pratique, d’abord règle islamique apparaît de plus en plus comme un effet de mode.
Il est 10 heures au lycée John Fitzgerald Kennedy, un établissement de jeunes filles niché dans le quartier de Colobane, non loin du marché à puces éponyme et de la place de la Nation (ex Obélisque). Ici, c’est l’heure de la récréation.
Un quart d’heure dans la cour de ce lycée dakarois réservé aux filles permet de constater que le voile islamique a fini d’avoir une place de choix dans l’habillement des élèves de cet établissement secondaire laïc. En effet, ce foulard est très visible sur la tête de bon nombre de lycéennes.
Assises par petits groupes, des voilées expliquent avoir voulu se conformer aux exigences de la religion musulmane qui recommande aux filles de se couvrir la tête.
Pour d’autres, le port du voile obéit juste à un effet de mode ou encore à des considérations économiques. Ces dernières estiment que le fait de se voiler est toujours moins cher que de recourir aux perruques, qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses.
Mais pour toutes, le port du voile est avantageux, procurant notamment le respect des autres.
»J’ai remarqué que depuis que je porte le voile, les gens me respectent davantage et m’accordent beaucoup plus de considération. C’est une des raisons qui m’encourage à continuer à le porter’’, explique Marième, une lycéenne trouvée en pleine discussion avec ses camarades.
Sa camarade Bintou est du même avis. Elle fait savoir que depuis qu’elle porte le voile, elle constate que les adultes la traitent avec respect et considération. ‘’Il s’y ajoute que mes parents me font davantage confiance et cela a beaucoup renforcé nos liens’’, ajoute-t-elle.
Aida, une autre élève voilée, rencontrée au lycée Delafosse, un établissement secondaire mixte de la capitale sénégalaise, liste les nombreux avantages reçus du fait simplement qu’elle porte le voile.
»Le regard des gens à mon égard a beaucoup changé depuis que j’ai commencé à porter le voile. Avant, je m’habillais en tenue plutôt moulante et, dans mon quartier, je me faisais importuner par les avances des garçons, souvent de manière pas toujours correcte. Ce qui n’est plus le cas.’’, pense-t-elle.
‘’Lorsque je prends le bus il arrive que des jeunes hommes se lèvent pour me céder la place’’, fait-elle observer, relevant qu’à la place de ‘’Miss’’ ou ‘’Nana’’, elle se fait désormais appeler ‘’Yaye Boye’’ (maman), ‘’Yaay Fall’’ ou ‘Sokhna Ci’’ (grande dame).
Marième Wade dit porter le voile pour une motivation toute particulière. ‘’Je porte le voile depuis un an. C’est à la suite d’une grave maladie que l’on m’a conseillé de me couvrir la tête. Depuis, je me suis mise au voile. La peur de retomber malade me pousse à maintenir le voile et j’ai fini par m’y habituer’’, témoigne-t-elle en mettant en avant des considérations sanitaires.
Effet de mode et calcul économique
Un parent ayant fait le constat que du jour au lendemain, toutes ses filles portent le voile, exulte. ‘’Je ne peux que m’en réjouir d’autant plus que je dépensais minimum 20000 FCFA par mois dans les salons de coiffure’’, confie-t-il devant le portail du lycée Maurice Delafosse.
Maimouna abonde presque dans le même sens. ‘’Je peux acheter 5 foulards de différentes couleurs et les utiliser durant toute l’année scolaire alors que, quand je ne portais pas le voile, je dépensais au minimum 5000 FCFA tous les 15 jours pour me tresser. Et pendant les moments de fête, il fallait débourser minimum 100 mille FCFA pour se payer une perruque’’, confie t-elle.
De l’observance d’une règle religieuse, le port du voile est également devenu une tendance prisée pour être à la mode. C’est du moins l’avis de ce vendeur de voiles et foulards au marché HLM de Dakar. Selon lui, ‘’le port du voile est très à la mode. Il peut être porté aussi bien avec des tenues traditionnelles qu’avec des habits modernes. Même des non-musulmanes se plaisent à le porter’’.
Au lycée John Fitzgerald Kennedy, la censeure, qui porte le voile, rappelle quelques règles sur les coiffures.
« Nous sommes dans une école laïque. Je suis moi-même voilée mais je ne prête pas attention à qui porte le voile et qui ne le porte pas. Par contre on est très regardant sur les coiffures extravagantes et les perruques interdites par le règlement intérieur de l’école », fait valoir Mme Fall.
« Je porte le voile par conviction religieuse mais je ne vais jamais faire sa promotion dans notre établissement qui est laïc. Certaines filles portent le voile par conviction religieuse et d’autres par mimétisme », souligne la censeure.
De son côté, l’islamologue, Cheikh Sadibou Diaga, estime que le voile ne doit pas être considéré par celles qui le porte comme un accessoire de mode pour suivre une certaine tendance. ‘’Il ne suffit pas seulement de porter le voile pour faire tendance, mais il faut plutôt l’adopter comme une exigence religieuse’’, dit-il.
Il a souligné aussi la nécessité de faire la différence entre l’Hijab (voile ou foulard en arabe) dont le port émane d’une recommandation religieuse et la Burka qui ne le serait pas.
‘’Le coran parle du hidjab qui consiste à couvrir la tête jusqu’au menton en laissant visibles les yeux, le nez et la bouche. La burka consistant à couvrir l’intégralité du corps est née d’une histoire entre le prophète Mohamed (PSL) et Hinda, la femme de Abou Sofiane, un oncle du prophète’’, explique l’islamologue.
Cheikh Sadibou Diaga rappelle qu’à l’époque du prophète Mouhamed (PSL), la première femme à porter la burka l’avait fait pour que le prophète de l’islam ne la reconnaisse pas. Elle avait toujours manifesté une hostilité envers les musulmans. C’est ainsi que le prophète lui avait demandé de l’enlever et de rester avec le hijab.
Le sociologue Abdou Khadre Sanogo affirme déceler un effet de mode dans l’amplification du port du voile, qu’il qualifie de ‘’phénomène’’. ‘’Il faut considérer que le phénomène du port de voile est beaucoup plus lié à la mode qu’à autre chose’’, dit-il, car, selon lui, ‘’on se rend compte que les filles le portent, mais continuent de s’habiller avec des tenues moulantes’’.
Le chercheur soulève aussi la dimension économique en raison de la cherté des perruques dont le coût peut varier entre 100 et 200 mille francs.
Il signale par ailleurs que des femmes peuvent mettre le voile pour masquer des balafres, cicatrices et encore dissimuler une forme déplaisante de leur cou, de leur tête.
A l’en croire, se couvrir la tête, est en réalité conforme aux réalités africaines en raison entre autres des effets du soleil, du mal de tête devenu un problème de santé publique. Aussi, certains guérisseurs traditionnels n’hésitent pas à recommander à leurs patientes de se couvrir la tête.
‘’C’est un peu cet imbroglio là qu’il va falloir prendre en compte pour attester de ce comportement social là’’, fait-il remarquer non sans rappeler que beaucoup de femmes font du voile un signe d’appartenance et d’adhésion à la religion musulmane.
‘’Elles s’habillent en couvrant tout le corps. Elles sont dans la pratique religieuse et sont donc différentes de celles qui sont à la fois dans la mode, l’aspect économique ou la propension à paraitre appréciable’’, explique Abdou Khadre Sanogo.
AFD/SMD/ABB/OID/AKS


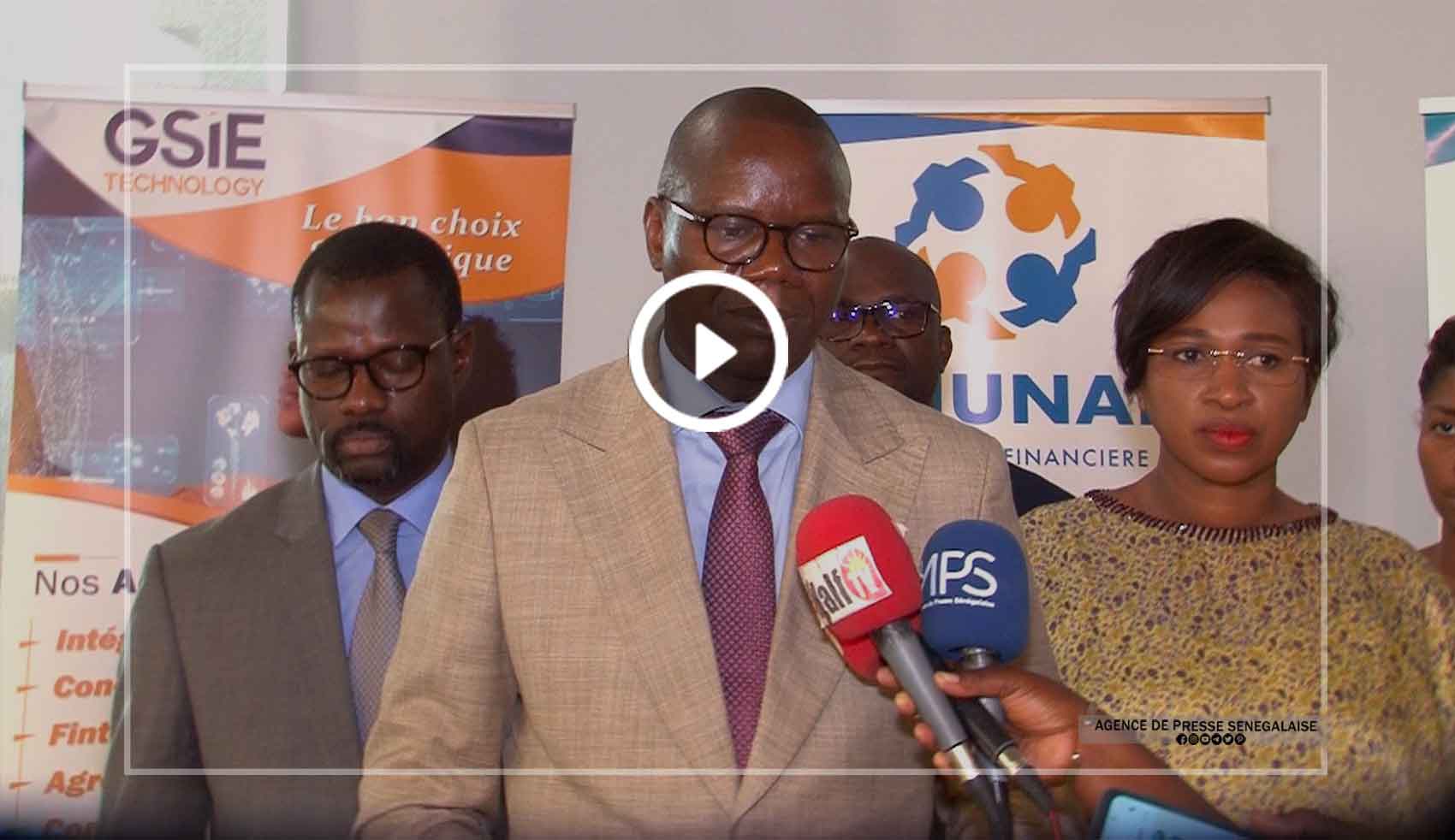
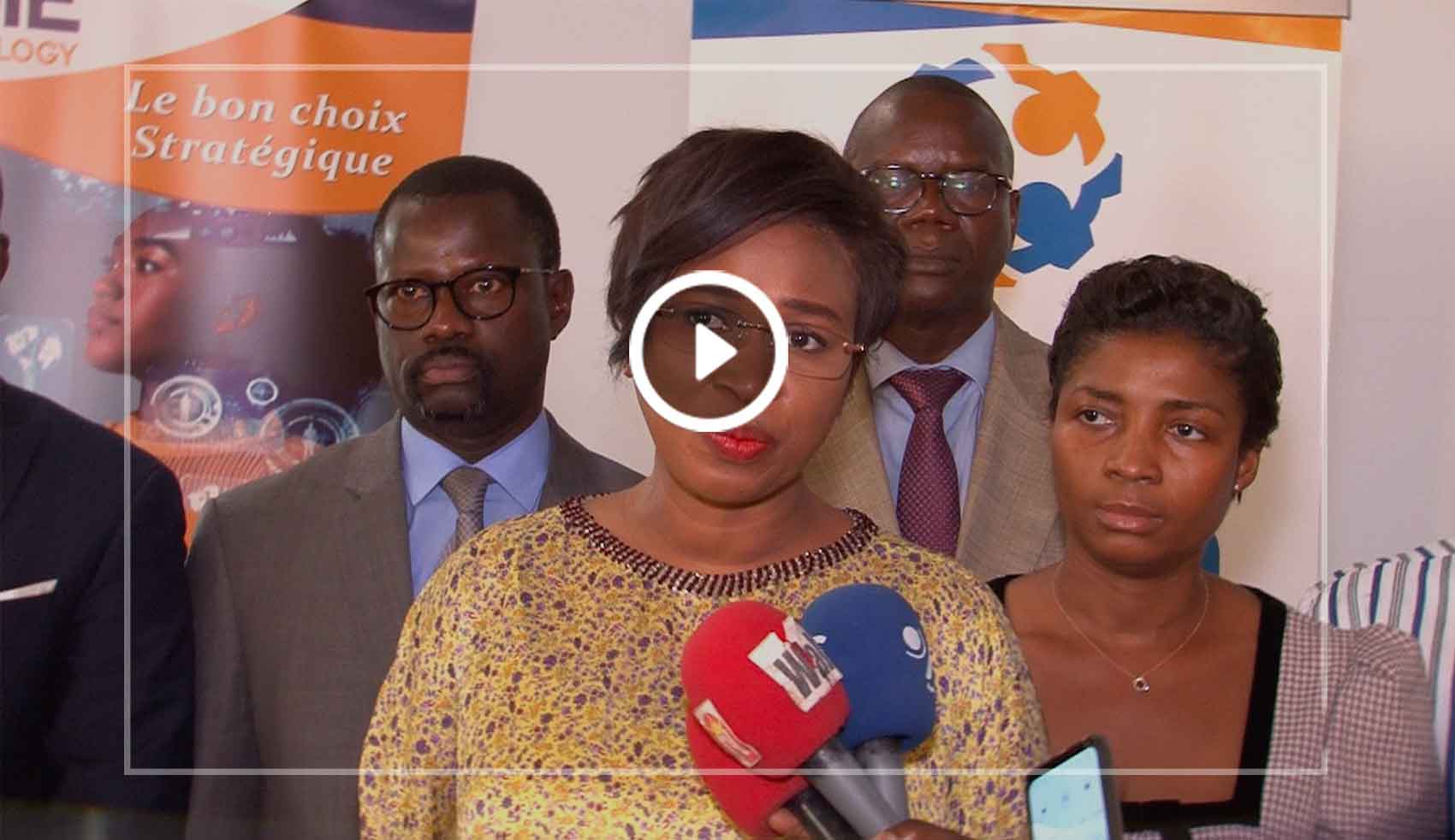

 ADL/ASB/OID
ADL/ASB/OID

 MKB/ADI/ASB/OID
MKB/ADI/ASB/OID





