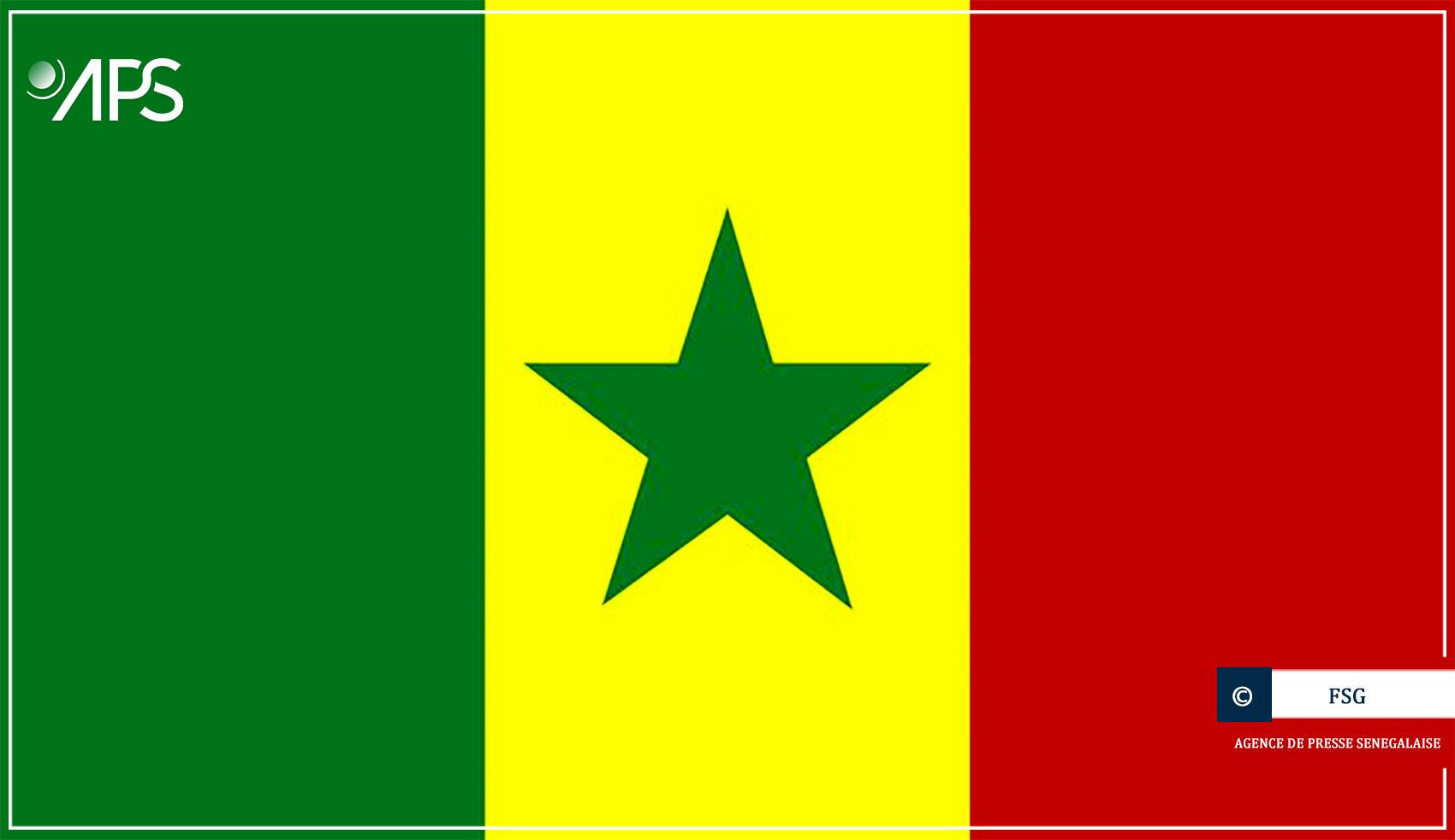Par Amadou Ba
Dakar, 18 jan (APS) – Au stade de projet lors du lancement des travaux par les autorités sénégalaises en décembre 2019, le Musée-mémorial ‘’Le Joola’’, érigé sur les berges du fleuve Casamance, est devenu une réalité depuis le 17 janvier 2024 avec son inauguration par le Premier ministre, Amadou Ba. Un édifice contre l’oubli et pour le souvenir en hommage aux 1 800 morts de douze nationalités différentes du naufrage, au large de la Gambie, du bateau Le Joola, le 26 septembre 2002, plus grande tragédie maritime de l’histoire.
Dans la vie de toute nation existent des marqueurs tantôt joyeux, tantôt tristes, mais tous faisant partie de l’histoire d’un peuple. Le naufrage du bateau Le Joola est de ceux-là, rappelant ce soir de sinistre mémoire quand le ferry reliant Dakar à Ziguinchor a sombré au large des côtes gambiennes. Et comme d’une dette dont les vivants veulent s’acquitter envers leurs morts, l’État du Sénégal a érigé un édifice mémoriel, un projet piloté par Sokhna Fall Gaye, administratrice du Musée.
»Le mémorial du bateau Le Joola aura pour mission de se dresser contre l’oubli, de rendre hommage à ces centaines de victimes dont le souvenir douloureux est resté un traumatisme national’’, résume Sokhna Fall Gaye, dans un entretien avec l’APS. Sa réalisation est la satisfaction d’une vieille doléance des familles de victimes par le président de la République Macky Sall. C’est à la suite d’un consensus avec elles qu’il a pris l’engagement de son érection à Ziguinchor.
Le projet a débuté en 2015 avec le lancement du concours national d’architecture remporté par le cabinet Archi Design et associés, le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de construction. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, à travers le Service du mémorial, en est le maître d’ouvrage.
Quelques péripéties liées à l’emplacement initial qui empiétait sur le domaine portuaire, des études géotechniques qui laissaient à désirer avaient ralenti à ses débuts sa réalisation. Mais selon Mme Gaye, ‘’la ferme décision de le réaliser a permis de procéder au lancement, en 2017, d’un appel d’offres en procédure d’urgence pour les travaux de construction, et l’entreprise Eiffage SA a été déclarée attributaire du marché.’’
Selon elle, ‘’après réflexion et échanges avec les communautés et parties prenantes au projet, la recherche d’un site répondant aux critères des familles de victimes–bordure du fleuve, route de passage du bateau et proximité avec de la gare maritime de Ziguinchor– était engagée.’’
‘’Rôle didactique et de prévention des catastrophes’’
Ainsi, ‘’en 2018, sous la conduite des autorités administratives locales, des services techniques, des représentants des communautés, des associations des parents de victimes, le site sis au quartier Escale a été retenu’’, se souvient-elle.
Il s’étend sur 5 838 m². 48% représentent un titre foncier tandis que les 52% restants, qui abritent des commerces, sont dédiés au mémorial.
Et en 2020, après des opérations d’indemnisation, les travaux de construction pouvaient commencer. Le mémorial occupe 52% de la superficie totale. Pour sécuriser le tout, un décret a été pris, déclarant d’utilité publique le mémorial du bateau Le Joola.
L’année suivante, en 2021, un comité scientifique et technique est mis en place pour la définition des contenus et l’élaboration du discours muséographique.
D’un coût global de trois milliards de francs CFA, l’infrastructure a été inaugurée mardi.
En plus de permettre aux familles des victimes de faire leur deuil, le mémorial Le Joola participe du travail de mémoire. Mme Gaye le résume si bien en ces termes : ‘’Tout acte posé relativement au souvenir du Joola s’inscrit dans le partage responsable d’une histoire et d’une mémoire collective’’.
L’édification de ce mémorial est d’une importance historique et sociale telle qu’il peut jouer un grand rôle dans la prévention et la gestion des catastrophes. Selon son administratrice, ‘’il se veut un instrument de veille qui doit constamment rappeler aux populations la responsabilité citoyenne, individuelle et collective dans la prévention des catastrophes. Il aura pour vocation, dans son volet didactique, de sensibiliser les populations dans la prévention des risques par le respect de l’ordre et de la loi.’’
Le partage d’une histoire commune avec le monde
Un mémorial combinant par essence une dimension de souvenir et un aspect culturel, celui du Joola n’échappera pas à la règle. Il sera ainsi en plus d’un symbole de commémoration, un espace touristique. C’est pourquoi, selon Mme Gaye, ‘’la diversité et le caractère inédit des expositions, combinés à la particularité de l’infrastructure, permettront de développer une attraction assez importante pour les visiteurs sénégalais, de la sous-région et du monde entier avec qui nous partageons ce triste pan de notre histoire commune.’’
Mme Sokhna Fall Gaye, administratrice du musée-mémorial Le Joola
Dans cette veine, deux composantes – l’animation scientifique et l’animation culturelle – liées à son fonctionnement vont favoriser la recherche et le développement d’activités connexes avec différentes associations liées au musée, les artistes, ainsi que tous les pays ayant perdu des ressortissants dans ce drame.
‘’L’animation scientifique permettra au musée de développer des programmes et des projets de partenariat avec les autres musées à travers le monde, les universités, les centres de recherche et de documentation, les institutions internationales’’, fait savoir Mme Gaye. Le mémorial aura donc pour vocation de servir d’incubateur pour les chercheurs et les étudiants qui travaillent sur des questions liées au naufrage, à l’histoire de la navigation et de la Casamance en général.
‘’L’animation culturelle, quant à elle, permettra de développer des activités avec les différentes associations des familles de victimes et des rescapés. Ce volet permettra aussi d’associer des artistes pour des prestations en lien avec cette histoire commune. Les centres culturels régionaux et sous régionaux seront conviés dans les activités d’hommage aux victimes de ce drame’’, ajoute l’administratrice.
Par ailleurs, la gestion d’un tel ouvrage nécessite une approche holistique. Mme Gaye l’a si bien compris qu’elle suggère que ‘’le type de gouvernance le plus indiqué pour le Musée-mémorial est d’en faire un édifice public à caractère administratif (EPA). Ainsi, la gestion sera collégiale avec l’ensemble des acteurs et des parties prenantes.’’
Pour elle, ‘’tout acte posé relativement au souvenir du Joola s’inscrit dans le partage responsable d’une histoire et d’une mémoire collective’’. Faisant que ‘’la douleur de la tragédie puisse être transformée en une séquence vive et vivante, celle qui permet de surmonter les plus grandes difficultés pour en faire le fondement d’actions constructives.’’
Ainsi, les familles des victimes se consoleront de l’érection du mémorial, en attendant le renflouement de l’épave du bateau, qu’elles appellent ardemment de leurs voeux.

ABB/OID/ASG