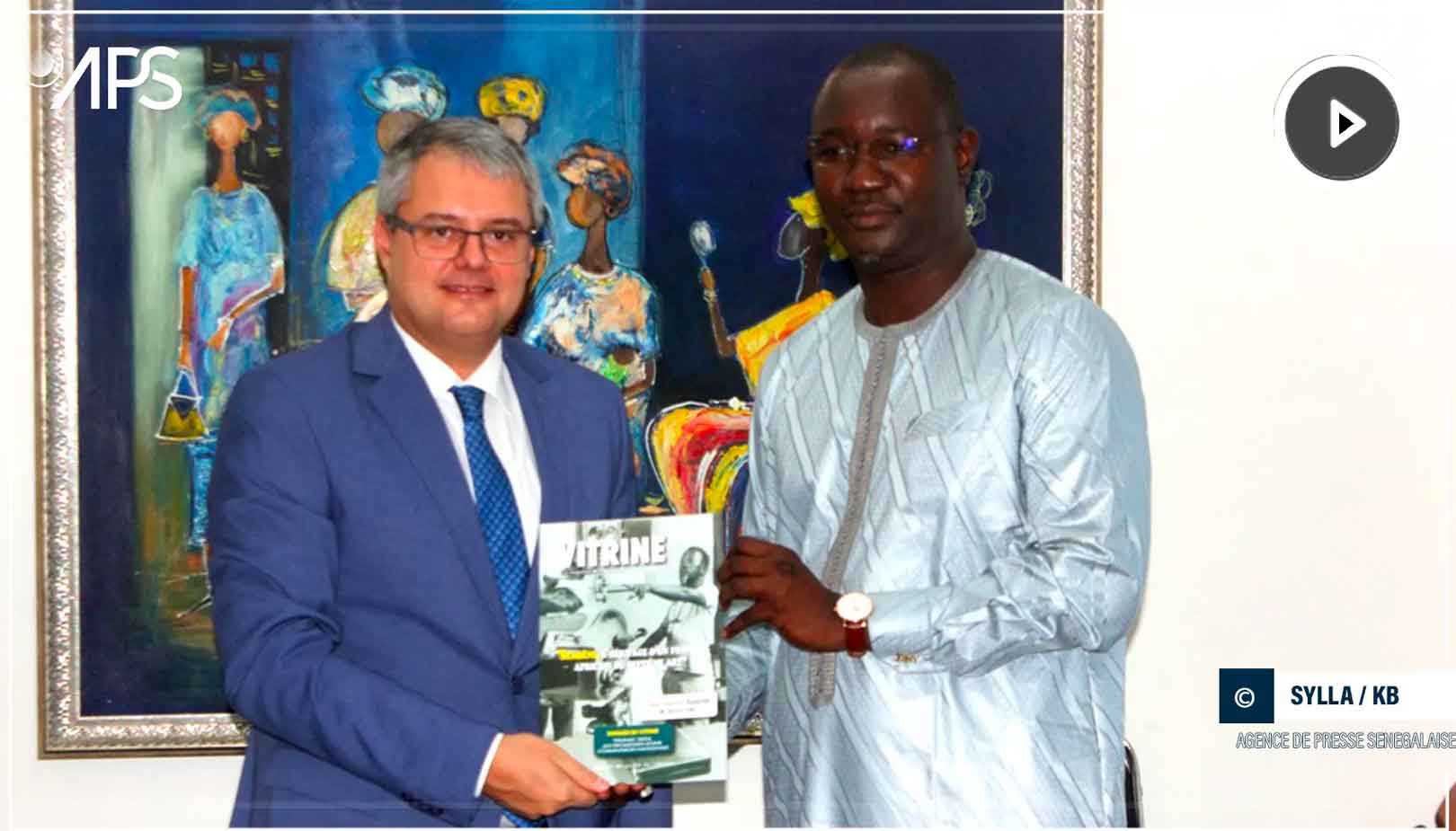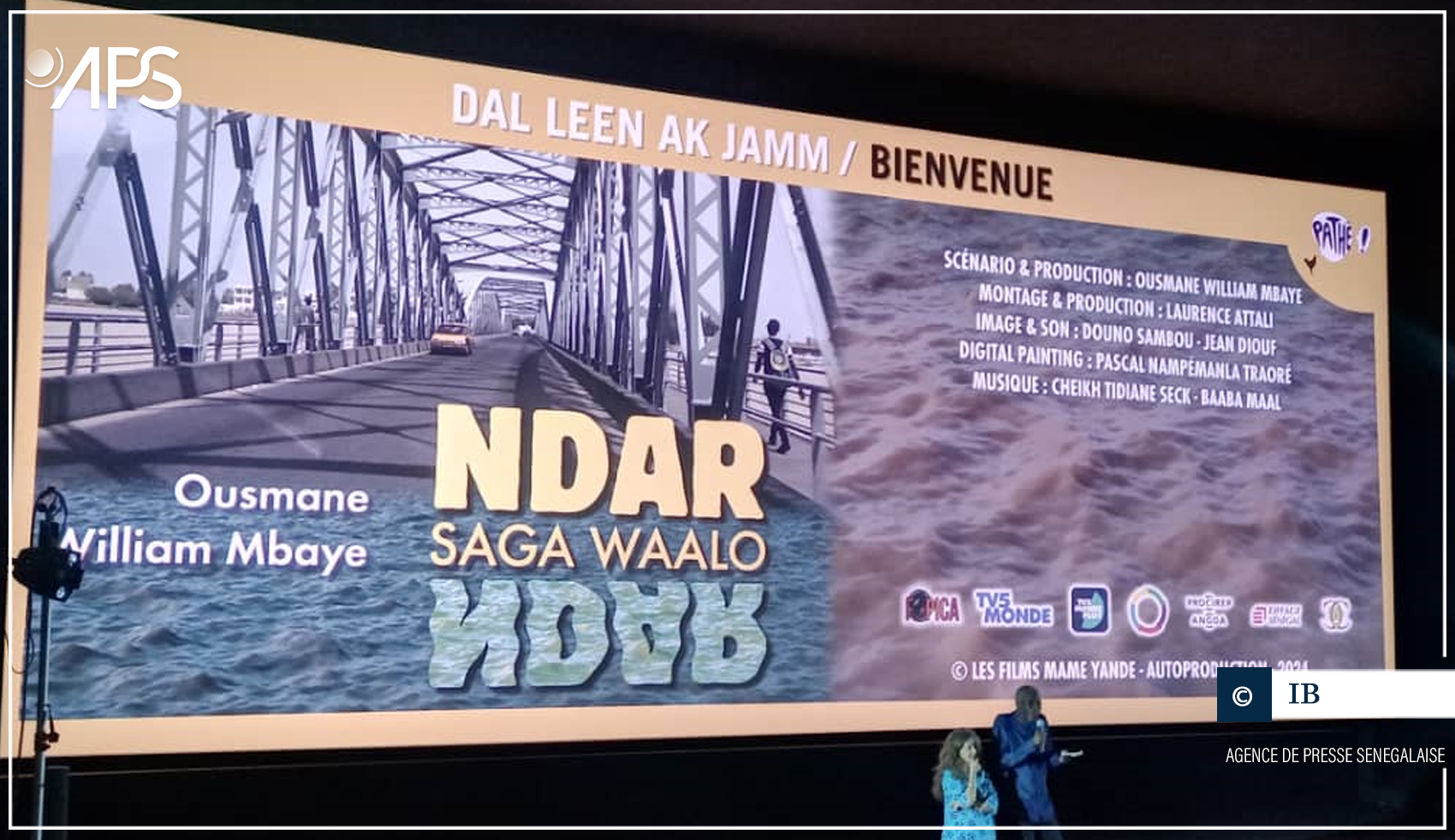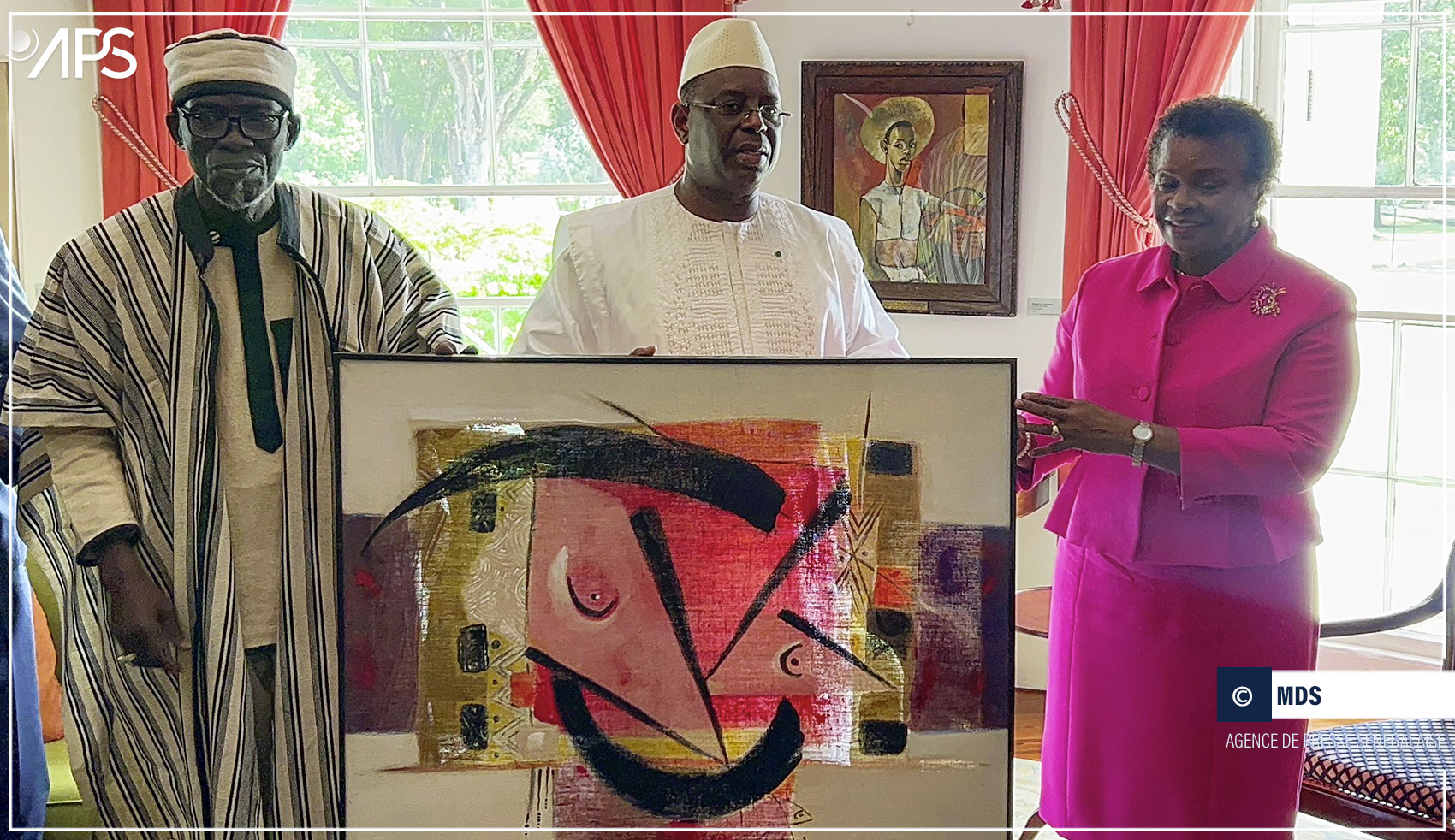Dakar, 14 fév (APS) – L’organisation panafricaine sénégalaise de protection de la démocratie et des droits de l’homme ‘’AfricTivistes’’ et les journalistes sénégalais Moussa Ngom et Ayoba Faye annoncent avoir saisi la Cour de justice de la Cedeao pour dénoncer les coupures d’Internet par les autorités sénégalaises en juin, juillet et août 2023.
Dans un communiqué de presse reçu, mardi, à l’APS, ils rappellent que le recours a été déposé le 31 janvier 2024 en collaboration avec ‘’Médias defence’’ (Organisme international qui défend les journalistes contre les menaces juridiques qui violent le droit à la liberté d’expression) et le ‘’Rule of law impact lab de la stanford lmaw school’’ en réponse aux restrictions imposées par le Sénégal sur Internet.
Les plaignants expliquent que cette procédure vise à obtenir des mesures provisoires pour »protéger le public sénégalais contre d’autres potentielles coupures lors de la prochaine élection présidentielle prévue initialement le 25 février 2024 aujourd’hui reportée au 15 décembre 2014 ».
Pour les plaignants, ‘’ces coupures intempestives des données mobiles d’internet violent les droits à la liberté d’expression ainsi que le droit des journalistes à travailler’’. Elles étouffent »de manière significative la liberté des médias et la liberté d’expression au Sénégal’’.
‘’Le recours déposé devant la Cour de justice de la Cedeao conteste les actions du gouvernement sénégalais, mettant en avant l’impact préjudiciable sur la liberté d’expression, la liberté des médias et le droit au travail’’, a déclaré le président ‘’AfricTivistes’’, Cheikh Fall.
Il souligne qu’en période d’agitation politique, »l’accès à l’information est crucial, et les coupures d’internet ne font qu’approfondir les ténèbres, entravant la circulation des informations vitales et mettant en danger la sécurité des citoyens’’.
La requête des plaignants rappelle que du 1er juin au 8 juin 2023, en réponse aux nombreuses manifestations contre la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, le gouvernement sénégalais a mis en œuvre un blocage complet des principales plateformes de médias sociaux.
Du 4 au 7 juin 2023, les services d’internet mobile ont été entièrement suspendus dans plusieurs régions, signalent-ils.
‘’Les autorités sénégalaises ont de nouveau restreint l’accès à Internet du 31 juillet au 7 août, de 8h à 2h du matin. Bien que les données mobiles aient finalement été rétablies le 7 août 2023, TikTok, dont l’accès avait été restreint le 2 août, reste inaccessible à ce jour sans l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN)’’, soulignent les plaignants dans le document transmis.
Ils dénoncent la nouvelle restriction de l’accès à l’Internet mobile survenue les 4, 5 et 6 février et celle du 13 février où l’internet des données mobiles a été suspendu “selon certaines plages horaires non communiquées », selon ‘’AfricTivistes’’
Les plaignants indiquent que ‘’97% des internautes utilisent ce mode de connexion, selon un rapport de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) ».
Pour AfricTivistes, ‘’ceux qui dépendent habituellement d’Internet pour obtenir des informations sont laissés dans l’ignorance. De plus, lors de la répression violente de certaines manifestations, le blocage d’Internet a empêché le partage d’informations importantes sur les zones sûres et sur la manière de contacter les services d’urgence’’.
FKS/OID