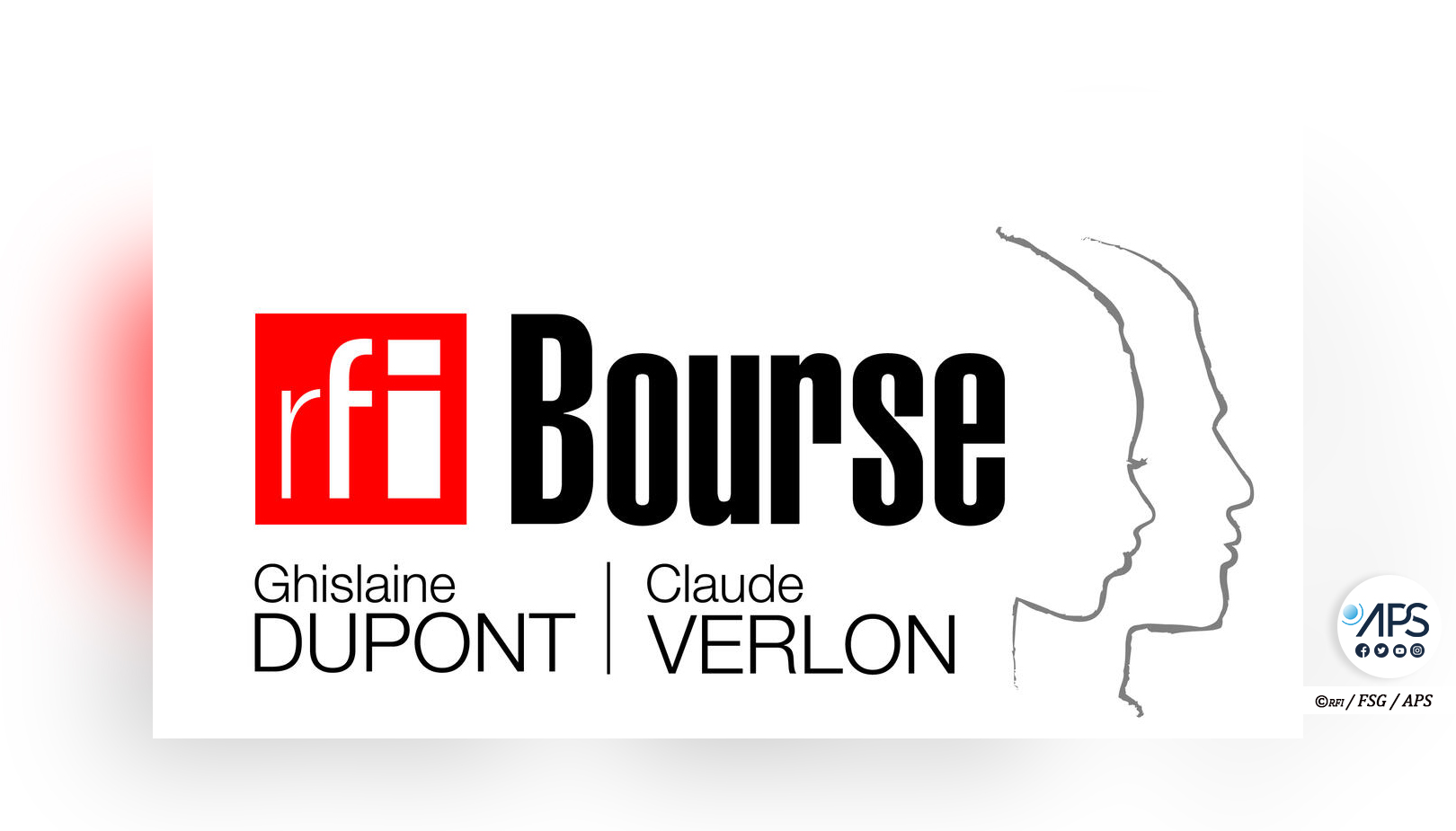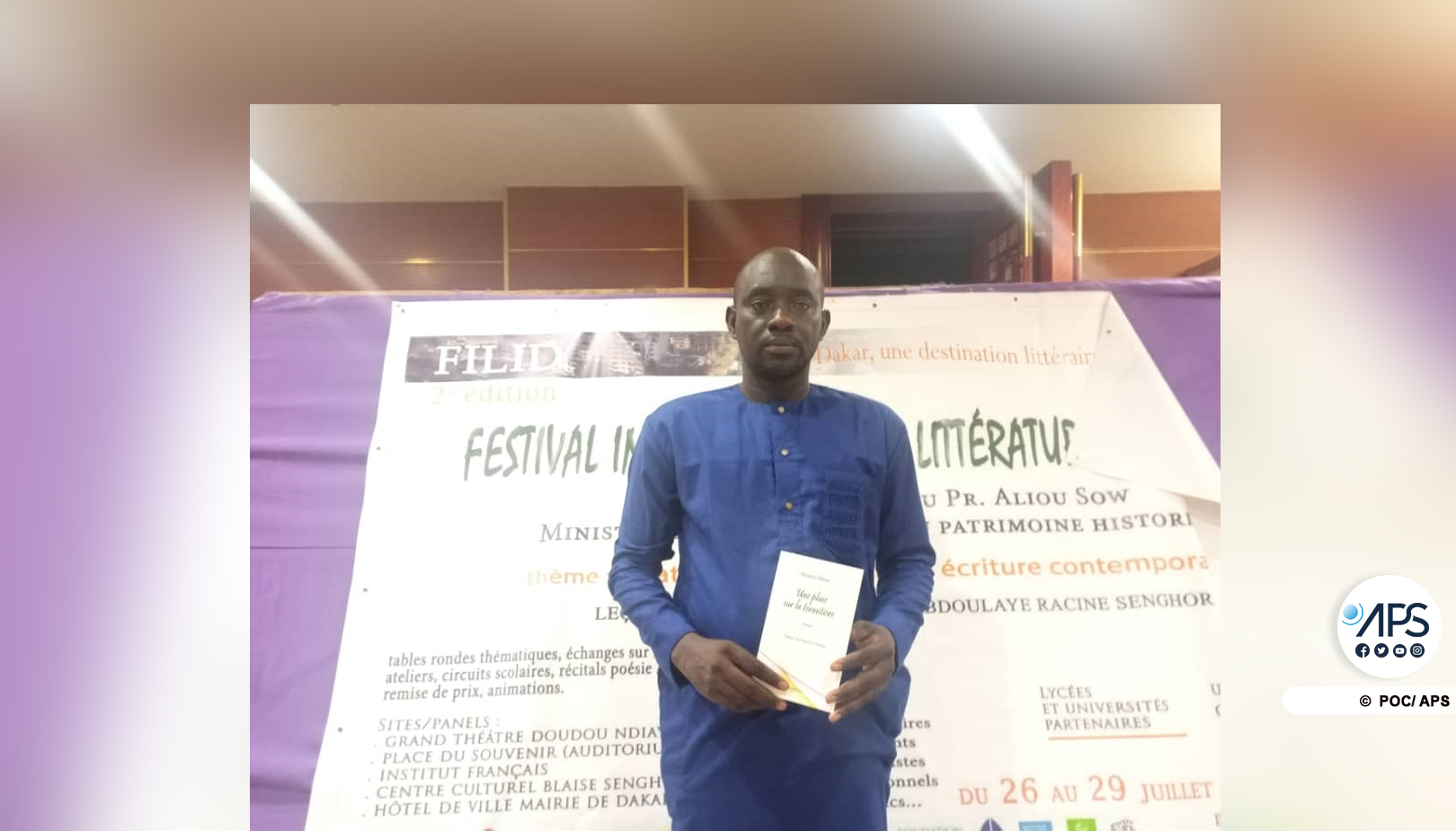+++ De l’envoyée spéciale de l’APS, Aïssatou Bâ +++
Kinshasa, 1-er août (APS) – Des œuvres d’artistes sénégalais composés de photographies et de la peinture sont exposées au musée national congolais où différents artistes venus de plusieurs pays francophones montrent leur travail dans le cadre de l’exposition concours des 9-èmes jeux de la francophonie (28 juillet-au 6 août). Les œuvres des Sénégalais renvoient l’une à la valeur de la rencontre des cultures à travers l’art et l’autre à l’énergie existant dans les villes africaines, selon leurs auteurs.
Le musée a trois salles d’expositions, dont l’une d’entre loge plusieurs œuvres des participants. Dès l’entrée de l’aile droite du musée national congolais, un bâtiment de 6 000 m2, construit en 2019, à gauche d’un mur peint en blanc, sont accrochés quatre clichés au fond noir, dont l’auteur est le photographe sénégalais El Hadji Samba Diédhiou.
Ces quatre imposantes photos sont le symbole de la rencontre entre les peuples. Elles parlent de la photographie, du photographe et de son sujet, a souligné l’artiste. »Ces images expliquent le lien existant entre le photographe et son sujet, ainsi que l’énergie positive reliant le monde », dit-il.
L’auteur a utilisé le digital painting (une technique de peinture sur ordinateur) en mettant en exergue de la couleur noir et blanc avec des textures de couleurs vives dans cette série intitulée »Ndadié » (Rencontre, en wolof), permettant de faire sortir le message transmis par les danseurs qui figurent sur les images.
Le choix de ces couleurs n’est pas anodin. Selon El Hadji Samba Diédhiou, elles ont été utilisées pour démontrer comment la photo a évoluée au fil des années en quittant le noir et blanc pour favoriser aujourd’hui la couleur. »Je me questionnais sur cette évolution, en vue d’essayer de trouver cet équilibre existant dans la photographie, tout en captant des émotions, des images et trouver une réponse à cette interrogation’’, explique Diédhiou.
Ces œuvres sont aussi une façon de se poser des questions sur l’évolution de la photographie pour inviter le spectateur à venir vivre l’envie de la photographie. Elle permet non seulement d’admirer, mais aussi de se poser des questions susceptibles de trouver des solutions.
»C’est une très grande satisfaction d’avoir fait cette recherche qui anime ma créativité, pour essayer de trouver cet équilibre », relève l’artiste qui souligne que ces photos restent un choix »pour éviter de faire comme les autres, sortir de l’ordinaire et pousser les gens à réfléchir ».
‘’Il y a tout un travail derrière le post photo avant d’arriver au stade de la photographie proprement dite. Ces personnes sur les photos dégagent des messages. Ce sont des danseurs et au-delà, ce sont des corps humains et quand ils parlent, on capte les yeux’’, insiste-t-il.
Du »Suwer », une technique revisitée par Fally Sène Sow pour une nouvelle écriture plastique
A droite des œuvres de Diédhiou, se trouve un tableau en verre sur lequel les images symbolisent la vie dans la cité. Cette œuvre composée d’herbes synthétiques, du coton, de la peinture, du fil à coudre, des petites photos découpées, des plumes, entre autres, affichée en face d’un mini jardin à l’intérieur de l’une des salles d’expositions du musée, donne un aperçu de la vie au quotidien.
Il est fait sur un support en verre et du contre-plaqué derrière. Dénommée »Suwer », cette technique traditionnelle de peinture au Sénégal a été revisitée par le concepteur de l’œuvre, le peintre Fally Sène Sow qui à travers cette technique veut apporter une nouvelle écriture plastique personnel à cette ancienne pratique artistique. Cette technique, réalisée depuis 2010, a permis à l’artiste de participer à plusieurs expositions à l’échelle nationale et internationale. Il a exposé à la dernière biennale de l’art africain contemporain de Dakar, dans le IN
Elle a été une source de découverte de l’artiste. »C’est une technique que j’ai utilisée dès mon jeune âge, en 2010, elle m’a permis de me faire connaitre. Elle m’est particulière et c’est en elle que je trouve mes meilleures expressions », lance-t-il sur un ton rassurant.
L’auteur met en exergue sur ce tableau, de l’énergie et les vibrations existant dans la société africaine. ‘’Il symbolise l’énergie en Afrique en termes de bouillonnement, des couleurs, d’effervescence. C’est ce que l’on trouve dans cette ville, le paysage et un coq au-dessus, dont les plumes tombent’’, relève-t-il.
Avec comme titre »Qui prend la plume ? », l’œuvre de Fally Sène Sow incite à la lecture, à la littérature, etc. A ce sujet, il dit : ‘’Mon travail a été inspiré par ma passion pour l’écriture et la lecture dès mon jeune âge, raison pour laquelle j’ai titré cette œuvre +Qui prend la plume ? +. C’est aussi un hommage aux hommes des lettres d’Afrique, à la littérature africaine et aux écrivains français qui ont nourri très tôt mon esprit ».
L’exposition de ces œuvres en concours a réuni plusieurs artistes peintres, photographes, sculpteurs venus de plusieurs francophones tels que les peintres Wilfried Mbida du Cameroun et Caroline Douville du Canada. Parmi le public, on note la présence de l’ambassadeur des jeux de la francophonie, l’ancien footballeur français Lilian Thuram qui a invité les jeunes à cultiver »l’estime de soi » pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
AMN/SBS/FKS/ADC