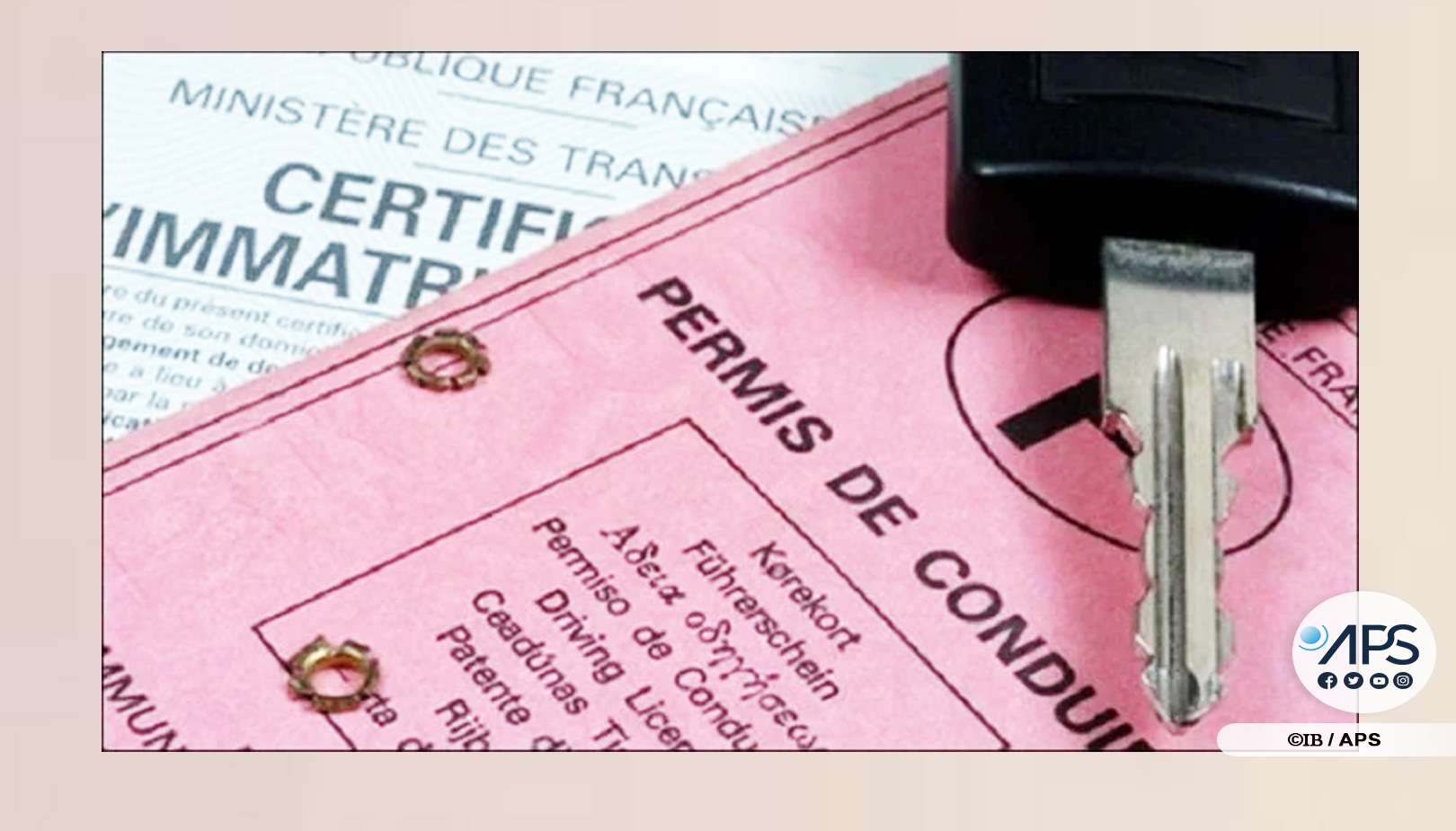Saly, 20 oct (APS) – La tranche 15-35 ans présente plus de risques de subir les accidents de travail dans les milieux professionnels, a déclaré vendredi, à Saly (Mbour, ouest), la directrice de la Prévention des risques professionnels à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).
»Les données des analyses de terrain qui nous sont remontées nous informent que la tranche 15-35 ans présente le plus fort taux de sinistralité dans nos milieux professionnels », a dit Marie Diallo.
Elle s’exprimait au cours d’un atelier de validation technique du projet d’intégration de la santé et sécurité au travail (SST) dans la formation professionnelle et technique qui se tient à Saly du 19 au 21 octobre prochain.
Ce projet, est selon Mme Diallo, un moyen pour le Sénégal de »bien sécuriser son capital humain », avant d’évoquer la tendance baissière des accidents de travail depuis 2014.
‘‘ (…) d’ici le mois de décembre, on aura les chiffres réels. Mais, on est sous la barre des 1800 accidents de travail là où y a dix ans, on était dans les 2500 accidents », a-t-elle signalé, saluant « une avancée notable ».
« L’objectif du projet est de doter tout futur travailleur de compétences requises en sécurité et santé au travail à investir dans le milieu du travail qu’il soit formel ou informel », a précisé le Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette rencontre.
Citant le Bureau international du travail (BIT), Mamadou Camara Fall a rappelé que 160 millions de travailleurs dans le monde souffrent de maladies professionnelles et 270 millions sont victimes d’accidents du travail.
Le BIT définit la Sécurité et la santé au travail (SST) comme étant « un ensemble d’actions destinées à prévenir les risques professionnels, à protéger et à promouvoir la santé des travailleurs par l’évaluation et la gestion des différents risques présents en milieu de travail », a expliqué M. Fall.
Ces risques peuvent être de diverses natures : psychosociaux, physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et mécaniques, a-t-il ajouté.
« Le travail tue au total 2,3 millions de travailleurs et de travailleuses chaque année, soit 6 300 personnes par jour. Cela entraîne des pertes en ressources humaines dont les coûts sont estimés à près de 4 % du Produit national brut annuel », a-t-il rappelé.
Selon lui, « le préjudice est également social, parce qu’entraînant l’absentéisme, le raccourcissement de la vie professionnelle pour cause d’invalidité, le chômage et la pauvreté ».
En Afrique, a-t-il indiqué, « du fait des insuffisances de la protection en SST, les risques liés à l’exercice d’un emploi sont 2,5 fois plus élevés que la moyenne mondiale. Ce qui nécessite de porter une attention particulière aux secteurs d’activités à haut risque ainsi qu’au secteur informel ».
« Sur le plan national, le nombre d’accidents du travail est passé de 2 246 en 2013 à 2 465 en 2014, puis à 1 906 en 2015, selon le Programme national de sécurité et santé au travail », a précisé Mamadou Camara Fall.
Le diagnostic fait dans le cadre du profil national de SST a révélé entre autre un manque de personnel qualifié en matière de SST, une carence dans la gestion de l’information en matière de SST et une ineffectivité de la SST dans l’administration, a-t-il listé, appelant a plus d’efforts.
Mouhamed Mokhtar Loum, conseiller technique du Directeur général du Travail et de la sécurité social, a estimé que de nombreux travailleurs sont obligés de vivre avec « un traumatisme ineffable » à la suite d’accidents de travail. Mais, il estime que « l’accident de travail n’a rien de fatal et il est possible d’enrayer les risques, d’éviter et d’empêcher convenablement que l’accident se produise ».
MF/ASB/OID