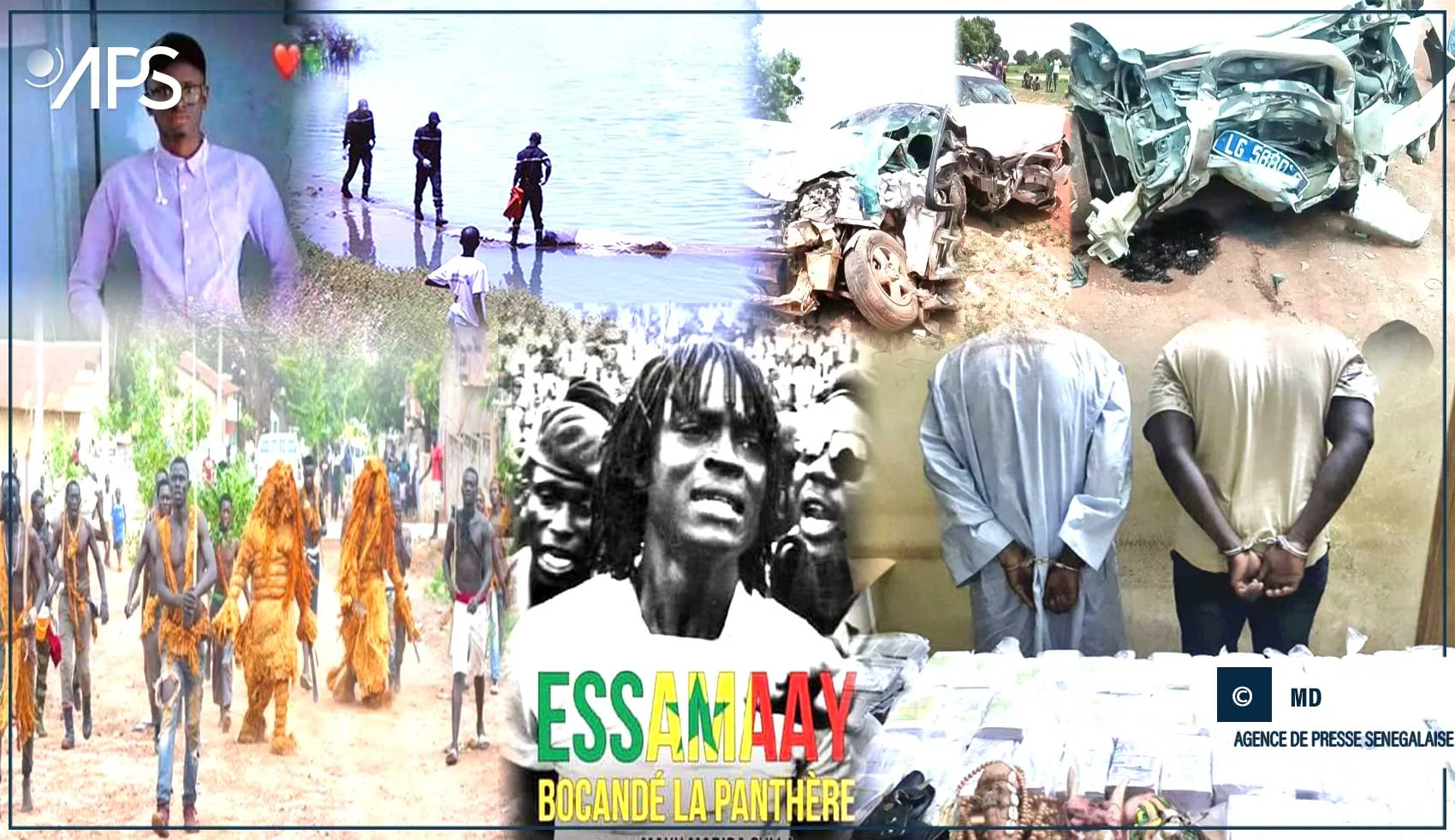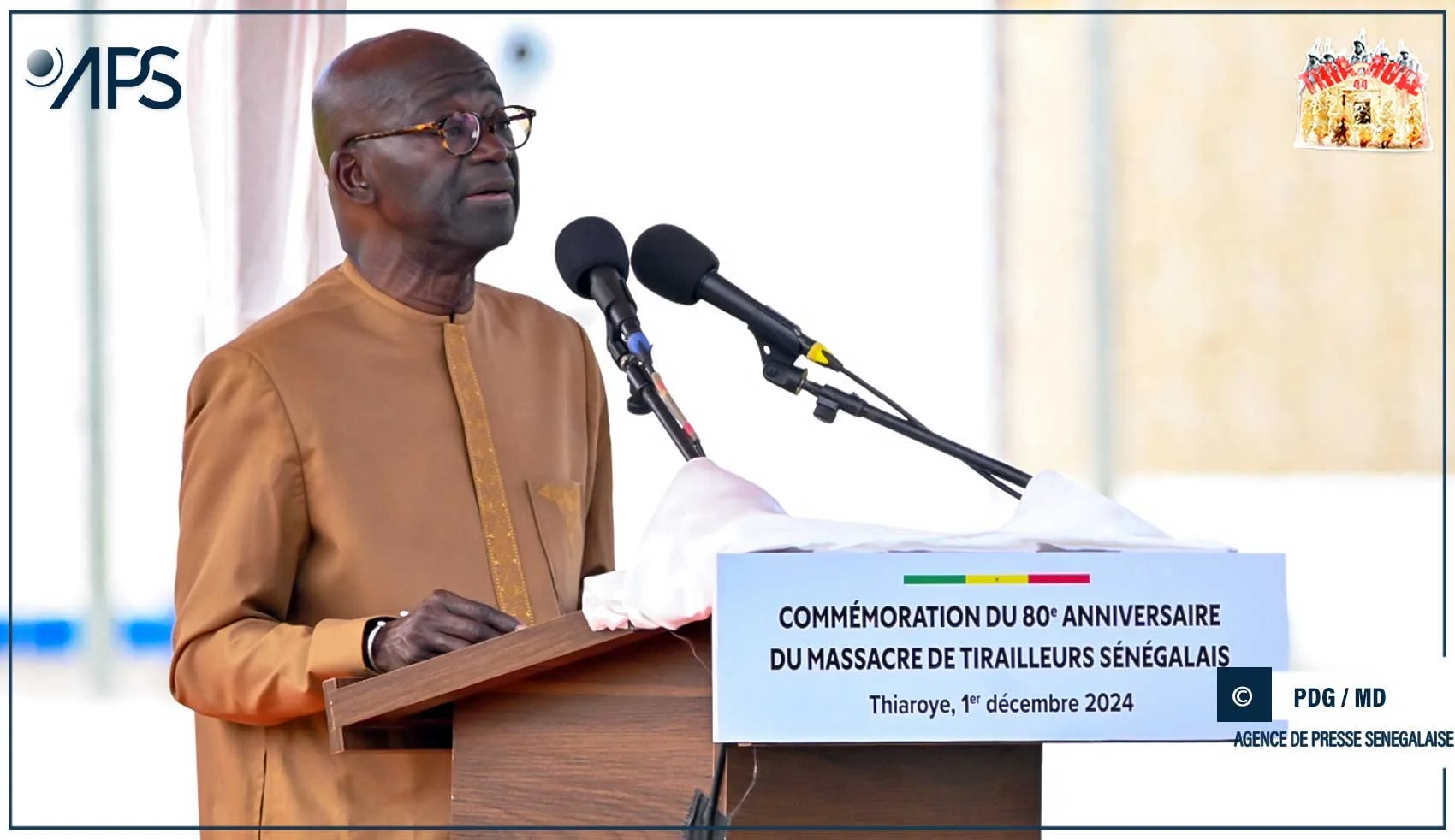Diao Insaba (Sédhiou), 21 déc (APS) – A Diao Insaba, un village de la commune de Bémet (Sédhiou), des perspectives s’ouvrent pour les femmes en termes d’activités génératrices de revenus avec la valorisation du potentiel ostréicole locale initiée dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds pour l’application des Normes et le Développement du Commerce (STDF).
Le projet de renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) qui vise à promouvoir la sécurité sanitaire des coquillages et leur accès aux marchés régional et international, est mis en œuvre par le Fonds des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le gouvernement du Sénégal, avec l’appui du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’objectif est d’améliorer l’exploitation des coquillages, les rendre plus salubres et sains pour la consommation humaine et permettre ainsi leur exportation vers des marchés porteurs en les mettant aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS), selon la FAO
Pour s’assurer de la sécurité sanitaire des coquillages, des prélèvements mensuels sont effectués sur 50 sites de production répartis dans les régions de Saint-Louis, Louga, Thiès, Fatick, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor depuis janvier 2024. Des prélèvements analysés par le laboratoire national.
Au Sénégal, la saison ostréicole s’étend de novembre à avril. L’huître est réputée pour ses richesses en vitamines, oligoéléments, protéines, sa cueillette est un travail épuisant. Une fois cueillies, les huitres sont séchées et cuites pour être consommées ou vendues.
La tendance est désormais d’aller progressivement vers la vente et la consommation d’huitres fraîches pour augmenter les revenus des acteurs. Par exemple, une douzaine d’huitres fraîches dans un pot peut revenir entre 4500 francs Cfa et 6000 francs Cfa alors que le kilogramme d’huitres séchées, qui nécessite au moins plusieurs douzaines d’huitres, est vendu à 4000 francs à 6000 francs Cfa.
Toutefois, cette option de la consommation d’huitres fraiches requiert le respect des conditions d’hygiène. En effet, le processus de l’alimentation de l’huitre résulte de deux actions : le pompage et la filtration. Pour se nourrir, les coquillages filtreurs pompent l’eau afin de capter les particules nécessaires à leur alimentation par filtration, une source de contamination pour l’huitre en ingurgitant des contaminants chimiques et de micro-organismes indésirables présents dans l’eau, notamment les virus, les bactéries, les microalgues toxiques et les contaminants chimiques.

Technique traditionnelle de cueillette
Ce qui le rend impropre à la consommation, surtout pour les huitres fraiches. D’où la nécessité de disposer de certaines infrastructures pour le transport et la conservation. Un problème auquel la FAO cherche à apporter des solutions avec le projet de renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers la mise aux normes Sanitaires et Phytosanitaires doté d’un budget de 854.518 dollars (environ 530 millions de FCfa).
En août 2022, une mission de la FAO a permis de découvrir un important gisement de coquillage dans la région de Sedhiou.
Au village de Diao Insaba, situé le long du fleuve Casamance, c’est la technique traditionnelle de cueillette qui prévaut sur place. Pour récolter les huitres, il faut pénétrer dans les eaux salées et froides de la mangrove pour arracher les coquillages accrochés aux racines des palétuviers. L’activité est encore timide malgré le potentiel dont regorge la zone.
‘’’Dans ce village, les femmes s’activaient principalement dans la riziculture. Mais de plus en plus, nous récoltons des huitres dans les mangroves. Toutes les femmes du village s’y activent. Il n’y a pas encore une organisation formelle, mais nous récoltons ensemble les huitres et faisons le séchage nécessaire avant la consommation du produit. La récolte est vendue dans le village ou aux rares clients de passage à DiaoInsaba’’, confie Aminata Mané à la fin d’une matinée de cueillette dans les eaux du fleuve Casamance.
Faute de clients, le gain est dérisoire. ‘’Nous vendons le pot d’huitres séchées à 500 francs Cfa. Et cette vente peut générer entre 4000 et 6000 francs. Cet argent est reversé dans une caisse’’, ajoute-t-elle.
Mme Mané et ses camarades saluent l’avènement du projet de la FAO dans la zone. Elles y voient des opportunités en termes de formation et de débouchés sur d’autres marchés. ‘’Le potentiel est là, mais nous avons besoin d’encadrement et de formation pour mieux valoriser notre production’’, plaide Adama Dabo.
Chef d’antenne de l’Agence nationale d’aquaculture (ANA) dans la région de Sédhiou, Abdoulaye Diallo, travaille avec les exploitantes de Diao Insaba. Une fois par mois, il est sur le terrain, avec Almamy Diatta, le chef de service départemental des pêches, dans le cadre du plan de surveillance des eaux.

‘’Sédhiou ne figurait sur la carte des zones de production d’huitres. Pourtant, elle a d’importants gisements de coquillages. Nous faisons un travail de sensibilisation auprès des femmes sur la coupe de la mangrove, par exemple. On leur apprend comment détacher les coquillages pour ne pas couper les racines. Si on coupe la racine, la plante meurt, et à la longue, ce sera la déforestation’’, explique-t-il.
M. Diallo voit les choses en grand. Son ambition, c’est d’ériger des parcs ostréicoles, c’est-à-dire des endroits où on pratique l’élevage d’huitres. ‘’L’avantage de ces parcs, c’est de fixer les larves sur des supports pour qu’elles ne soient emportés par les courants. Et cela permet de booster la production’’, dit-il.
Des techniques modernes à Katakalousse
Nouvellement affecté, le chef de service régional des Pêches, Serigne Thiam, s’enthousiasme également pour ce projet de valorisation des huitres au regard du potentiel de la zone.
Ces techniques modernes sont une réalité dans la région de Ziguinchor plus précisément à Katakalousse, dans la commune de Diémbéring. Ici, les femmes s’adonnent de plus en plus à l’ostréiculture, parallèlement à la méthode traditionnelle de cueillette.
Ce processus comporte le captage à l’aide de guirlandes ou de coupelles, c’est-à-dire la collecte des naissains (des larves) dans les palétuviers. Pour se faire, les femmes ont installé des collecteurs dans la mangrove sur lesquels viennent se fixer les larves d’huitres qui commencent à se développer. Au bout de plusieurs mois, ces naissains sont détachés et placés dans des pochons (sacs avec des mailles, servant de site de grossissement) pour que les huitres poursuivent leur croissance. Une fois, atteint le niveau de croissance requis, les huitres sont placées dans des bassins d’eau de mer appelés dégorgeoirs pour être lavées, triées et mises dans des bocaux pour la commercialisation.
Katakalousse dispose d’un dégorgeoir, un bassin qui permet un traitement plus efficace des huîtres, ce qui assure une production ostréicole de meilleure qualité. Le désengorgement des huitres est une technique qui permet d’entreposer les huîtres une fois sorties des pochons dans un compartiment ou dégorgeoir pendant 6 heures pour éliminer tous les résidus de vase et contenus du système digestif des huîtres.

Ensuite, les huîtres sont mises durant 24 à 48 heures dans un autre compartiment pour être purifier par brassage en micro bulle où l’eau est bien oxygénée puisque l’eau du bassin de purification est filtrée et stérilisée. Les huîtres une fois propres, sont récupérées et décortiquées.
‘’Pour la culture des huitres, il faut commencer par le captage, qui consiste à attirer le naissain vers le support. Les huitres ont besoin de substrat pour se fixer. Après ce fixage, les huitres sont collectées dans des pochons pour le prè-grossissement et le grossissement. Quand les huitres auront une taille bien déterminée, elles sont récoltées pour être mises dans des bassins de dégorgement, c’est ce qui le cas ici à Katakalousse. Et à une période donnée, elles seront récoltées pour être vendues ou transformées. C’est le tout le processus de la chaine de valeur depuis la mise en place des infrastructures d’élevage’’, explique Mariama Faye, chef du bureau régional de l’ANA à Ziguinchor et ex Point focal du projet sur l’aspect sanitaire.
Selon elle, ‘’l’ANA intervient dans le processus de mise en place des infrastructures d’élevage, essaye de moderniser un peu l’infrastructure, qui était un peu artisanale au début. Auparavant, la collecte se faisait dans les mangroves, mais l’ANA est intervenue avec l’ostréiculture, c’est à dire que les espèces sont placées dans des infrastructures pour être élevées. Parmi ces infrastructures d’élevages, il y a les pochons (sacs avec des mailles) et les coupelles’’.
Mariama Badji, elle, est formatrice dans une ONG. Depuis 2021, elle accompagne les femmes dans la confection des guirlandes, l’installation et la confection des pochons, le suivi et nettoyage des guirlandes. Membre du Réseau national de la chaîne de valeurs huitres, elle dirige également des séances de formation sur la transformation de l’huitre afin de valoriser le produit.
Selon elle, ‘’il y a une forte augmentation de la production avec les nouvelles de techniques de transformation’’

‘’Les femmes vont faire la cueillette, nettoient les huitres, avant de les dégorger. Après le dégorgement, elles font le tri. Pour l’huitre frais, la douzaine est vendue à 1000 f ou à 1500 f. Avant, elles faisaient le séchage qui n’est pas très rentable. Avec 70 kg d’huitres fraiches, tu te retrouves avec 1kg d’huitres séchées. On a voulu autonomiser ces femmes, elles ont été formées à la transformation. Les huitres fraiches sont mises dans des bocaux ou dans des barquettes’’, explique-t-elle, ajoutant que l’objectif est d’ériger un centre pour faciliter la commercialisation des produits.
Originaire du village de Ourong, Maimouna Gomis est présidente du GIE Sotiba. Maimouna, née en 1964, ne connait que la cueillette d’huitres. Une activité qui lui permet de gagner sa vie, d’entretenir sa famille. Plaidant pour l’amélioration de leurs conditions de travail, elle estime que les femmes, dont la plupart viennent des iles, ont besoin de pirogues, de gilets et de petits matériels pour augmenter leur production. Lors de la dernière campagne, elle confie avoir gagné 250 mille francs Cfa.
Surveillance des plans d’eau
A Katakalousse, ‘’le niveau est plus élevé’’, selon Abdalah Thiam, consultant sécurité et santé des aliments à la Fao et coordonnateur adjoint du projet. ‘’Les femmes disposent d’une bande de palétuviers importante sur lesquelles elles peuvent récolter des huitres. Parallèlement, elles ont installé des guirlandes pour capter des naissains. L’intérêt, c’est de pouvoir capter le maximum de naissains et les mettre dans les pochons pour le grossissement. En plus de cela, elles ont un bassin de dégorgement’’, souligne M. Thiam.
A en croire Abdalah Thiam, c’est ce que le projet vise, c’est d’aller au-delà. ‘’Il faudra savoir si produits ne sont pas contaminés par d’autres germes microbiologiques ou des contaminants chimiques. A la fin du plan de surveillance, on pourra classer un site et savoir effectivement si un site pourra continuer à faire le dégorgement ou si en plus de cela, il faudra une purification. Donc, parallèlement au bassin de dégorgement, on aura un bassin d’épuration. C’est-à-dire, ramener à un niveau de risque moins la contamination à un niveau de risque moins élevé’’, fait-il observer.
A Tobor, près de Ziguinchor, Mariama Faye, est venue effectuer des prélèvements. Entre ses mains, des isolants, des carboglaces et les matériels permettant de prendre les paramètres physico-chimiques. Avec ses baskets, elle entre dans l’eau jusqu’aux pochons en compagnie des femmes du GIE ‘’Youlaye’’ (huitre en Joola).
Ce travail de prélèvement est réalisé sur la base d’un protocole entre l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), le ministère des Pêche et la FAO. ‘’Ce document explique comment faire les prélèvements sur les 50 sites. Il faut commencer par une inspection du littoral, qui consiste à prendre l’ensemble des données géographiques, les contaminants. Ensuite, il y a le prélèvement mensuel proprement dit’’, souligne Mariama Faye.

‘’On prend un échantillon d’huitres. On fait une analyse microbiologique qui consiste à faire la classification des sites sur la base des critères de l’arrêté de classification du ministère des Pêches. Il faut constituer l’échantillon et le mettre dans de bonnes conditions. Il doit être acheminé dans les 24h. L’agent contrôleur est un agent du ministère des Pêches. Les prélèvements sont acheminés au laboratoire national d’analyse à Dakar. Le travail a démarré en janvier et doit être finalisé en février pour les interprétations et la classification’’, ajoute-t-elle.
Ce travail de classification est effectué en fonction du niveau de présence de l’Escherichia coli, un germe qui peut être présente dans les huitres.
‘’Pour chaque classe, on a un seuil à respecter sur la base des résultats d’analyse en Escherichia coli. Si le seuil est de 300 grammes par liquide intervalvaire, on dira que le site est classé A. sur ce site, on n’aura pas plus d’efforts pour pouvoir commercialiser les huitres. On récolte et on commercialise directement. Si le site est de classe B, on peut dégorger (nettoyer) avant de commercialiser. Si le site est de classe C, on doit faire une épuration dans des bassins avant de commercialiser. Si le site est de classe D, cela veut dire qu’il est inexploitable’’, explique la représentante régionale de l’ANA.
Un travail pénible et qui ne rapporte pas beaucoup
A Tobor, Mariama Diédhiou est à la tête de fédération ‘’Youlaye’’ (huitre en Joola), un groupement de six GIE composé de 40 femmes. Ce matin, elles sont venues inspecter les guirlandes et les pochons d’élevage. Le travail est dur et ne rapporte pas beaucoup.
‘’On est dans l’exploitation des huitres depuis longtemps. On utilise la méthode des guirlandes avec les coquillages pour capter les larves que nous élevons ensuite dans des pochons. Nous devons nettoyer les coquillages pour les maintenir propres. Ça ne rapporte pas beaucoup. Avec deux bassines, vous pouvez vous retrouver avec deux pots d’huitres séchées. Par contre, si les huitres sont bouillies et conservées dans des bocaux, c’est mieux. Nous mettons une douzaine d’huitres dans un bocal avec des carottes, de l’oignon, du vinaigre. Le bocal peut être vendu entre 1500 et 2000 francs Cfa. Nous le faisons depuis deux ans, surtout à l’occasion des foires. Mais actuellement, les conditions ne sont pas réunies pour faire ce travail. Il y a des normes d’hygiène à respecter. La nourriture est quelque chose de très sensible’’, dit-elle.
‘’Nos gains ne sont pas encore à la hauteur des efforts fournis. L’huitre peut mettre un an pour grossir. Lors de la dernière campagne, je n’ai pas gagné grand-chose. Beaucoup de femmes ont quitté le GIE, parce que l’activité ne rapporte pas énormément. Si c’est avec les huiles séchées, avec deux bassines d’huitres, vous allez vous retrouver avec deux pots que vous allez vendre’’, explique Mme Diédhiou.

Elle et ses camarades comptent beaucoup sur l’initiative de la FAO pour développer leur activité comme l’ont réussi les exploitants dans les Iles du Saloum. ‘’Là-bas, l’activité marche bien, alors qu’ici, en dépit du potentiel, nous peinons à nous en sortir. Nous espérons qu’avec ce projet de la FAO, les choses iront mieux’’, confie -t-elle.
A Thobor, comme dans la plupart des sites de production, les femmes travaillent plus sur la transformation artisanale. Un travail pénible et qui ne rapporte pas beaucoup. L’État et ses partenaires se sont engagés dans un processus de valorisation du potentiel ostréicole en misant sur la sécurité sanitaire des huîtres, une perspective porteuse, selon Dr Mamadou Ndiaye, Coordonnateur sous-régional du projet à la FAO.
»Nous avons été dans les zones de production et on a vu la pénibilité de cette transformation. En termes de rendements, selon les chiffres donnés, il faut 70 Kg d’huitres frais transformés pour avoir un kilogramme de produit séché. Le prix du Kg attient difficilement 5000 francs Cfa. Or si nous pouvons garantir la qualité sanitaire, on peut vendre le produit frais. De ce fait on peut valablement vendre une douzaine à 5000 f. Et on passe de 1 x 5000 à 70 x 5000 francs Cfa. La marge en termes de développement et d’amélioration des revenus est extrêmement importante. Travailler sur la certification des produits, c’est travailler à multiplier par 70 les revenus des acteurs de la filière qui sont à plus 80 % des femmes. On voit que bien les répercussions sociales que cela va entrainer’’, dit Dr Ndiaye.

OID/AKS/ADL