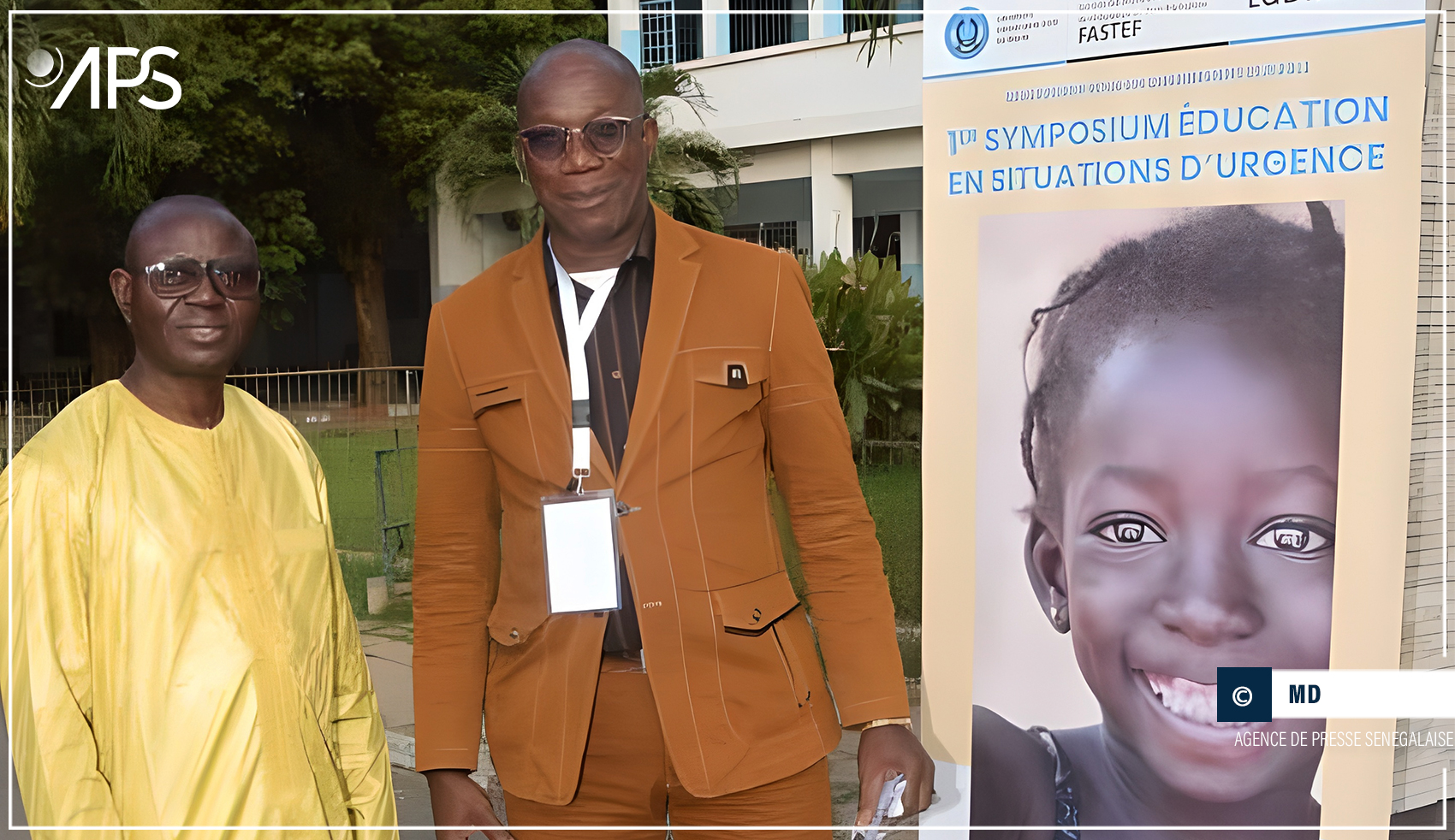Dakar, 28 déc (APS) – Quatre mille patients sont suivis au Centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar (Cepiad) dont ils constituent la « file active », tandis que 300 autres sont enrôlés dans le cadre du programme « méthadone » ciblant les utilisateurs de l’héroïne, a révélé le coordonnateur dudit centre.
‘’Actuellement, nous avons une file active de près de 4000 patients qui sont suivis par le Cepiad. On a également le programme méthadone qui continue à y inclure les gens dépendant des opiacés, notamment l’héroïne. Et dans ce programme, nous avons enregistré 300 personnes’’, a dit le Professeur Idrissa Ba.

Il s’exprimait lors des journées portes ouvertes du Cepiad, articulées autour du thème ‘’L’image négative du drogué au Sénégal : de la construction aux effets sociaux’’.
Le psychiatre indique que depuis que le centre est ouvert en 2015, il reçoit annuellement 500 nouvelles demandes par an.
Le responsable du Cepiad souligne que le programme méthadone ‘’est confronté à beaucoup de difficultés liées à la stigmatisation et la discrimination, qui font que les gens ont beaucoup de problèmes à avoir accès au programme mais surtout à y rester’’.
Face à cette situation, M. Ba dit compter sur ‘’la communication, le respect des droits humains, les réformes de nos politiques pour faciliter l’accès aux soins’’.
‘’On a parlé aussi d’un engagement plus fort de l’Etat. Parce que nous sommes engagés dans un processus de décentralisation avec quatre autres structures, celles de Thiaroye, Mbour, Kaolack et Mbacké. Il faut que l’Etat et les autorités s’impliquent davantage pour que nous puissions faire face à cette demande de plus en plus croissante’’, a plaidé le psychiatre.
Interpellé sur l’addiction chez les femmes, Idrissa Ba estime qu’elle ‘’n’est pas liée au sexe ou à l’âge’’.
»Les femmes constituent l’une de nos préoccupations. Elles constituent 10% de nos populations. Nous savons qu’il y en a plus, il faut que nous mettions beaucoup plus le focus sur ces femmes’’, a-t-il suggéré.
L’accent est mis sur les activités génératrices de revenus compte tenu du fait que ‘’dans l’addiction aussi, il y a un problème économique et social’’. ‘’Ce sont des femmes avec qui il faut faire des activités d’estime de soi comme la coiffure, la teinture, entre autres’’, a expliqué Idrissa ba.
Il précise que ces activités visent à favoriser la fréquentation du Cepiad.
Demba Koné, le directeur pays de l’Onusida’’, a souligné la nécessité de prévenir l’addiction. ‘’En revisitant la loi sur la drogue, nous pouvons faire des pas supplémentaires’’, a-t-il fait valoir.
Au Sénégal, la consommation de drogue étant punie par le code pénal, les acteurs de la lutte contre le Sida souhaitent la révision de ce cadre juridique qui considère le consommateur de drogue comme un délinquant.

NSS/ASG/AKS