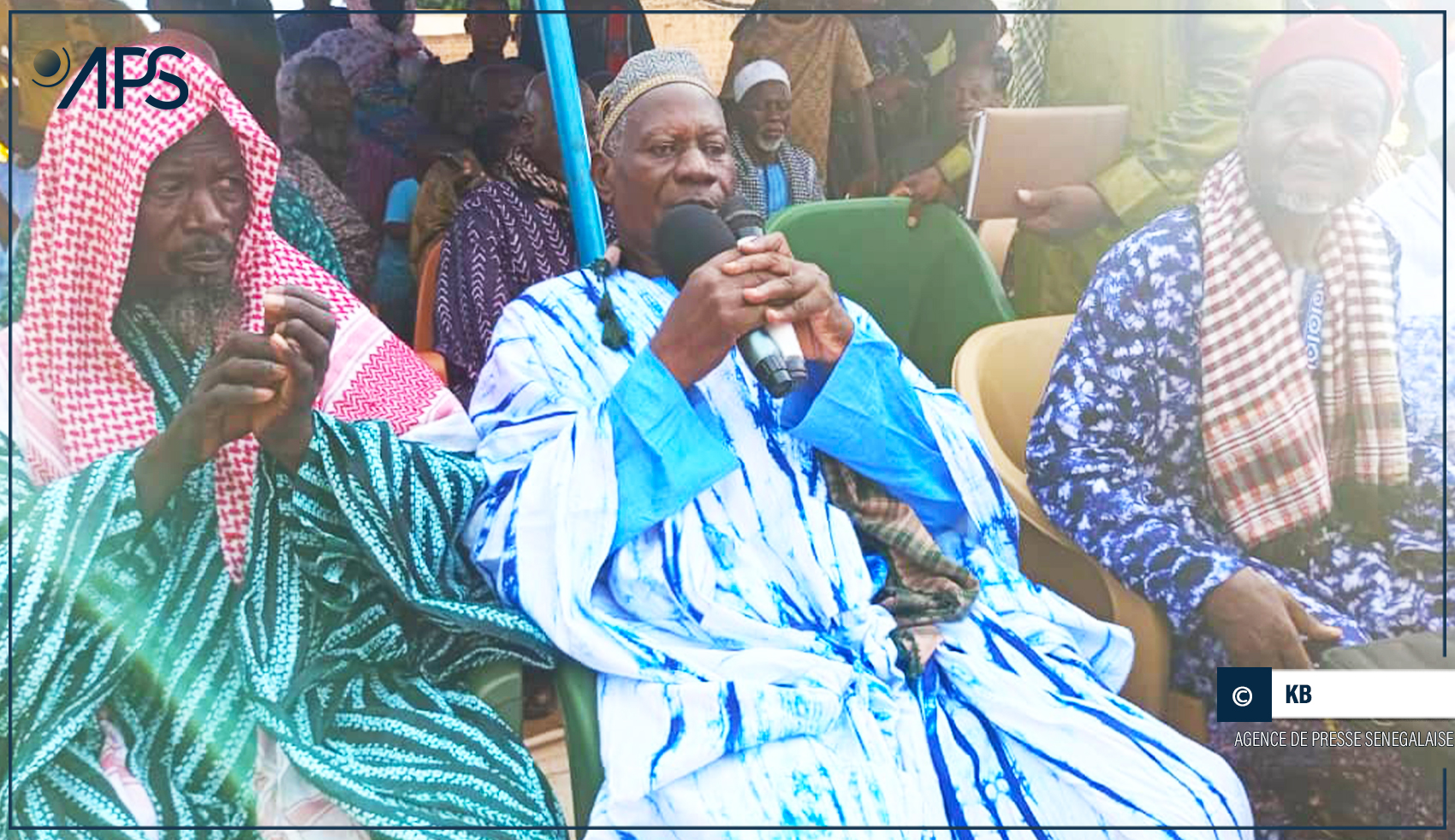De l’envoyé spécial de l’APS, Serigne Mbaye Dramé
Ankara, 30 sept (APS) – Moustapha Kémal Atatürk (1881-1938) n’a dirigé la Turquie, en tant que président de la République, que sur une période de 15 ans. Sa présence reste pourtant toujours vivace dans la conscience populaire. Une preuve parmi tant d’autres de l’attachement et de la reconnaissance des Turcs à son action de modernisation du pays, plus de 80 ans après sa mort.
Dans la métropole d’Ankara, les grandes avenues, l’environnement verdoyant, comme les gratte-ciels qui se profilent et défilent le long des routes entrecoupées par endroits de parcs végétaux, donnent une idée du grand bond réalisé par la Turquie en matière d’infrastructures ces dernières décennies.
De la même manière, le visiteur peut se faire une idée de la détermination avec laquelle le pays cherche à se faire une place dans le cercle des nations qui comptent, dans une région très complexe comme le Moyen-Orient peut se prévaloir de bien des acquis, sur le plan religieux, politique comme géographique.
Si le style des véhicules apparaissant moins extravagant et semble parfois contraster avec le niveau de développement économique et social du pays, la qualité des routes renseigne sur le chemin jusque-là parcouru par la Turquie en matière de développement.
Le visiteur venant d’un contexte géographique et politique déterminé comme le Sénégal, où c’est la photo officielle du président de la République en exercice qui décore les bureaux de l’administration publique, fait la curieuse découverte qu’en Turquie, c’est plutôt l’image de Moustapha Kémal qui s’impose partout et à tout le monde.
L’ombre tutélaire d’Atatürk
La photo du président en exercice apparait très rarement à côté de celle du fondateur de la République turque. Comme si la stature de celui que l’on appelle Atatürk – le père de la Turquie moderne – est au-dessus de tout.
Son buste trône encore aujourd’hui dans les établissements scolaires, les institutions militaires et universitaires, comme dans les bâtiments touristiques et les entreprises médiatiques, des décennies après sa mort en 1938.
Statues et graffitis dédiés à sa mémoire sont partout présents dans les villes turques, de même que ses nombreuses représentations, en tenue militaire ou habillé en civil, jusqu’au sommet de certaines collines au sortir de la ville.
Ce qui attise plus que tout la curiosité du visiteur, en l’incitant à s’intéresser à la dimension singulière de celui dont la trajectoire imprègne grandement la vie des Turcs et structure leur conscience mémorielle.
Il n’a dirigé le pays que durant une quinzaine d’années, de 1923 à 1938, mais il apparait aujourd’hui que cette période a grandement déterminé l’avenir de la Turquie, au point que le nom de Moustapha Kémal a fini par donner le rythme de la marche d’un pays placée à la croisée des civilisations occidentale et orientale, de par son histoire et sa géographie.
L’omniprésence de cette personnalité charismatique renseigne sur le besoin, dans la plupart des pays, d’une figure emblématique, presque transcendantale, qui dépasse les clivages et dont la pensée et l’action poussent les citoyens à tout donner pour leur pays.
Interpellée devant une peinture moins familière du défunt leader, une consœur de l’agence de presse officielle Anadolu, ne put s’empêcher une digression en réponse à la question : who is this man in the photo ?
Entre autres commentaires, elle rappela que c’est la photo du père de la République de Turquie. Comme si se limiter à la seule réponse attendue à la question, en donnant juste le nom de celui qui était représenté par cette peinture, serait blasphématoire ou ne dirait pas grand-chose sur l’histoire et l’évolution du pays.
La littérature renseigne également que ce militaire passé à la postérité sous le sobriquet Kémal, qui veut dire en arabe littéral le parfait, a préféré la construction d’une République moderne au vaste empire ottoman qui a dirigé le monde musulman à partir du début du XIIIe siècle jusqu’à l’abolition du califat islamique en 1924 et la dislocation de ses territoires hétérogènes sous l’impulsion justement du kémalisme triomphant de l’époque.
La sortie d’Atatürk de la domination linguistique et culturelle de la civilisation arabe pour bâtir une identité islamique propre à son peuple est un peu à l’image de la construction somme toute inachevée de ce que l’on a voulu appeler l’islam noir en Afrique au Sud du Sahara.
Une sorte d’islam propre aux Subsahariens et qui serait moins orthodoxe et moins érudit. Moustapha Kémal Atatürk s’était ainsi évertué à encourager la scolarisation de ses concitoyens à partir de l’alphabet latin et non plus par les caractères arabes. Lui-même étant né dans les territoires de la Grèce actuelle, il se faisait photographier en train de donner des cours d’alphabétisation en langue latine.
Cohabitation entre religion et modernité
Son approche moderniste souvent considérée comme un cas d’école dans les parcours universitaires sur le réformisme dans le monde arabo-musulman se manifeste dans la rue à travers notamment l’habillement et l’attitude très à l’occidentale de la femme turque. Cette modernisation, d’autres diront une occidentalisation à outrance de la vie publique, s’accompagne d’un strict respect du culte. Dans plusieurs services visités, même des bâtiments militaires, le visiteur peut naturellement apprécier l’érection d’une mosquée, ou tout au moins d’une salle de prière aménagée pour ceux qui veulent pratiquer leur religion, sans encombrement ou difficulté.
Le linguiste passionné ou l’activiste convaincu de l’importance de la conscience historique ne peut qu’apprécier positivement le recours que les peuples peuvent faire à leur langue et fonds culturels pour bâtir leur hégémonie et faire face aux agressions culturelles et idéologiques de plus en plus marquantes dans le monde contemporain. Et cela, même si parfois, en dehors des lieux de grandes rencontres, comme les restaurants, les rédactions ou les universités, le visiteur devra s’attendre à subir la barrière linguistique.
C’est le cas par exemple d’un confrère du Djibouti qui, cherchant un renseignement dans un lieu marchant, a vu la satisfaction de voir un de ses compatriotes maîtrisant la langue du pays lui venir au secours et lui servir d’interlocuteur, par le plus heureux des hasards.
Son interlocuteur turc n’a pu s’empêcher une remarque qui peut être étonnante : « Pourquoi votre frère ne parle pas notre langue comme vous ? ».
La conversation avec des gens qui vous interpellent, certainement pour savoir si tout se passait bien dans votre séjour, finit très souvent dans un éclat de rire contagieux, devant l’impossibilité de continuer la communication.
L’arabophone peut tout au plus comprendre les mots qui reviennent le plus souvent : Merhaba, Teşekkür, dont la racine en arabe renvoie au fait de souhaiter la bienvenue à quelqu’un ou de lui dire merci. Tout se passe comme si votre interlocuteur chercherait à vous dire merci quand-même, malgré la barrière de la langue.
Une autre curiosité du pays concerne l’usage très répandu de la cigarette, sans différence d’âge et de sexe, qui fait que votre interlocuteur peut ostensiblement allumer sa cigarette électronique ou classique, au détour d’une discussion, sans avoir la courtoisie ou l’élégance de vous demander si vous étiez fumeur ou si la fumée vous insupporte. Il fait comme c’était naturel de fumer. Comme on se délecterait si naturellement de la très variée et appréciable cuisine turque.
SMD/BK/ASG





 FKS/BK/ASG
FKS/BK/ASG







 AMN/ADL/OID
AMN/ADL/OID