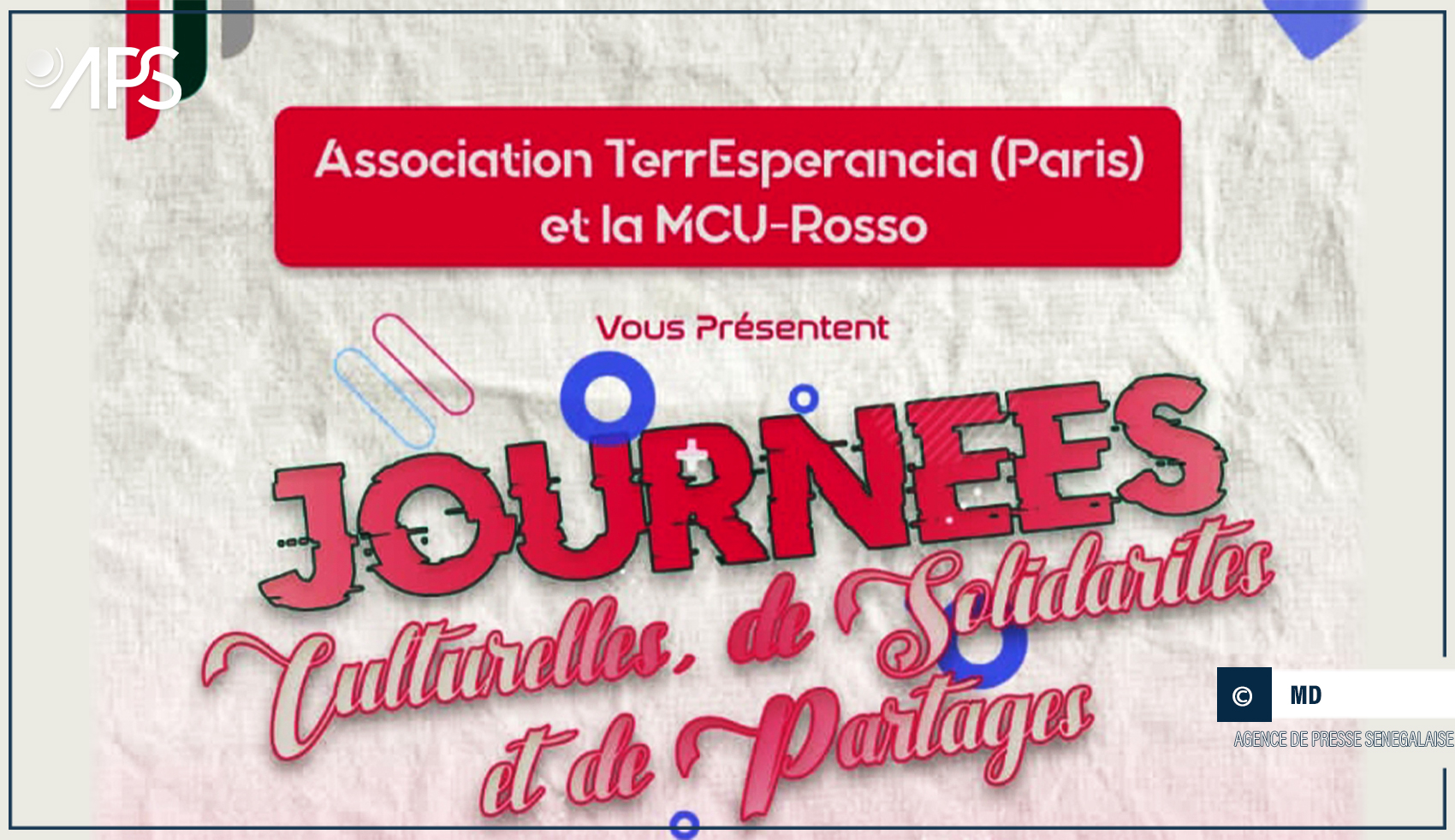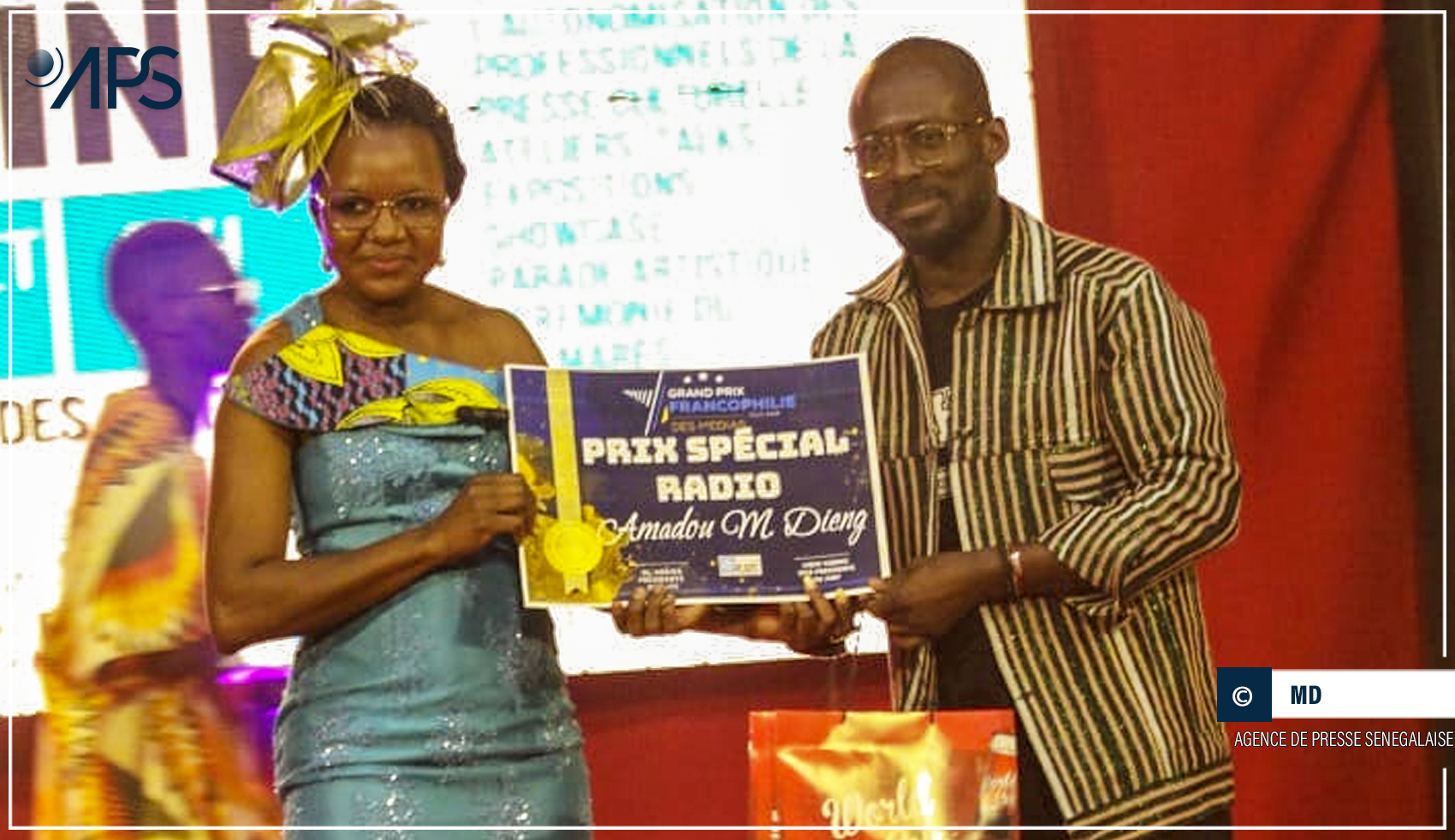Par Amadou Thiam
Matam, 29 juil (APS) – La ville de Matam est sans salle de cinéma depuis une trentaine d’années au moment où le réalisateur sénégalais Mamadou Dia, originaire de la région, est auréolé de plusieurs prix dans le monde avec ses films ‘’Baamum Nafi’’ (Le père de Nafi en pulaar) et ‘’Demba’’.
Ce manque d’infrastructures cinématographiques contraste avec les années fastes du 7e art à Matam où la salle de cinéma implantée par la famille Fadel, était la plus fréquentée dans cette commune du nord du Sénégal.
Aujourd’hui, cette unique salle de cinéma à Matam, située non loin de l’entrée de la commune, ne fonctionne plus. Le vieux local abandonné, se trouve à quelques pas de l’Eglise au quartier Tantadji, sur une ruelle bien animée et commerçante, longeant la célèbre avenue dénommée ‘’Angle Fadel’’.
Sur la devanture, sont garées de motos Jakarta en réparation. Sur le perron, le lieu est noirci par l’huile et tous les produits utilisés pour remettre ces engins en marche.
Au moins une dizaine de motos sont en panne ou attendent leurs propriétaires. A côté, assis sur un banc ou sur ces moyens de locomotion, des jeunes sont en train de discuter s’affairant autour des motos et inhalant de la fumée provenant de la dibiterie d’à côté.
Le local, il y a plus d’une vingtaine d’années était l’un des lieux les plus fréquentés de la ville. Les deux guichets, à peine visibles indiquent la nature de cet espace devenu aujourd’hui méconnaissable et impraticable.
A côté, se trouve la grande porte de ce haut lieu de culture. A l’intérieur, des adultes discutent accoudés sur des motos. Des rangées de bancs sont visibles. C’est l’unique salle de cinéma de Matam très populaire dans les années 1980.
Actuellement occupé par un atelier de réparation de motos, l’endroit est peuplé de gros arbres, l’écran a disparu, de même que la salle de projection qui servait de local pour le bobineur. A la place des spectateurs, ce sont des arbres qui y ont poussé, à tel point qu’on a l’impression d’être dans une minuscule forêt.
Pour bien comprendre les années fastes du cinéma à Matam, il faut aller à Soubalo, à l’ancien marché de ce populeux quartier de la commune, non loin de la berge du fleuve Sénégal.
Ici, ils sont nombreux à n’avoir pas rejoint le nouveau marché, situé à l’entrée de la ville.

Tailleur de profession, Abou Koulibaly est venu rendre visite à son ami Abdoul Wahab Fall alias Diallo Fall. Les deux hommes ont travaillé ensemble à la salle de cinéma qui se trouvait au quartier Tantadji.
Vêtu d’une tenue traditionnelle, des lunettes bien posées sur les yeux, Koulibaly, à l’époque officiait comme guichetier pour les tickets qui étaient vendus à 100 francs CFA.
La famille Fadel, créatrice de l’unique salle
‘’La salle de cinéma a commencé à fonctionner au début années 80. Il y avait deux guichets, l’un pour les tickets à 100 et l’autre à 200 francs CFA qui était tenu par feu Mamoudou Sy plus connu sous le nom de Doro Sy. Diallo Fall contrôlait les entrées. Il veillait à ce que chaque spectateur puisse s’assoir à sa place’’, se souvient Koulibaly.
Il se rappelle que les autorités servant dans la région appelées ‘’VIP’’ ne payaient pas. C’est son ami et collègue Diallo Fall qui avait la liste sur laquelle étaient inscrits les noms des personnalités dont l’entrée était gratuite notamment des fonctionnaires de l’administration territoriale, de la gendarmerie et de chefs de service.
Se replongeant dans ses souvenirs, le guichetier se rappelle que Boubacar Konaté était le projectionniste, avant que ce dernier ne quitte la ville pour être remplacé par Daouda Diallo.
‘’Chaque jour, on pouvait faire passer un à deux films. Dans la semaine, on pouvait mettre deux par jour pendant au moins cinq jours’’, se remémore Koulibaly.
Il rappelle qu’il y avait dans le bâtiment une chambrette en haut qui servait de local pour le projectionniste, précisant qu’elle a été détruite depuis que le cinéma a arrêté de fonctionner à Matam au début des années 90. Depuis lors, le lieu est occupé par des mécaniciens, y établissant un atelier de réparation de motos.
Selon le tailleur, à l’époque très actif dans le fonctionnement de la salle de cinéma, c’est Moustapha et Hamoud Fadel, deux sénégalais originaires du Liban qui ont été à l’initiative de l’implantation du cinéma dans la commune de Matam dans les années 80.
Leur père, Fadel Mesto s’est installé à Matam dans les années 30 grâce au commerce qui se faisait le long du fleuve.
En plus de la salle de cinéma, la famille possédait un hôtel et une boulangerie dans la commune. Le célèbre avenue ‘’Angle Fadel’’ tire son nom de Fadel Mesto. Aujourd’hui, ses petits-fils continuent de s’activer dans le commerce dans la région de Matam.
‘’A l’époque, c’est le cinéma qui animait la ville. Les gens étaient impatients d’aller voir un film, ils se bousculaient pour entrer. Diallo Fall était souvent débordé, car il devait séparer ceux qui ont payé des tickets de 100 francs de ceux qui ont acheté des places pour 200 francs. La ville vivait au rythme du cinéma’’, se remémore-t-il.
Selon lui, les hôtes de la ville trouvaient du temps pour aller voir un film au cinéma. A chaque fois qu’il y avait un bon film, les agents étaient débordés. ‘’C’était presque à guichet fermé’’, qui pouvait rapporter une recette de 100. 000 francs CFA, une grosse somme, à l’époque, lance-t-il.
Il précise que les films d’action étaient les plus suivis.
Son ami Abdou Wahab Fall explique de son côté que des amateurs venaient presque de tout le département, notamment des localités environnantes comme Ourossogui.
‘’Je me rendais à Dakar tous les quinze jours pour récupérer des films au siège de la Société d’importation, de distribution et d’exploitation du cinéma (SIDEC) avec Hamoud, un des frères de Moustapha avant de revenir sur Matam. Toutes mes activités étaient concentrées sur le cinéma’’, souligne Fall, qui regrette la vente du site à des privés, mais occupés par des réparateurs de motos.
Devenu commerçant depuis plusieurs années, il ne manque pas de se souvenir des années fastes du cinéma dans la ville de Matam. Il rappelle que parfois, l’affluence était tellement grande que les agents de sécurité pouvaient même en venir aux mains avec les spectateurs.
Selon lui, des tickets se vendaient au marché noir, des blessés étaient même enregistrés lors des bousculades. ‘’On utilisait un véhicule qui faisait le tour de la ville pour annoncer le film à l’affiche’’, dit-il.
Abdou Wahab Fall se souvient des coupures en plein film, ce qui énervait les spectateurs, dont certains n’hésitaient pas à insulter l’agent en charge des bobines qu’on recollait par la suite.

Des cinéphiles venaient de la Mauritanie voisine
Ils sont nombreux à se souvenir des années où la ville de Matam vivait au rythme du septième art. Le Directeur de la radio communautaire ‘’Dandé Mayo Fm’’, Madiagne Fall raconte que des habitants des autres localités environnantes venaient à Matam pour suivre des films.
Se replongeant dans ses souvenirs, Fall souligne que ‘’dès 19 heures, les responsables de la salle mettaient de la musique pour annoncer le film à venir’’.
‘’Il y avait des vendeurs aux alentours de la salle. Le commerce marchait bien à cette époque. En plus des habitants des autres villages, des Mauritaniens établis de l’autre côté de la rive traversaient pour venir à Matam pour voir des films. Ils venaient entre autres de Tokomadji, Siwé et Matam Rewo, en face de la commune de Matam en Mauritanie’’, se souvient Madiagne Fall.
Pour disposer d’un ticket d’entrée, avec d’autres amis, ils participaient à des loteries ou vendaient de l’herbe qu’ils vont chercher dans la brousse. Des gens venaient uniquement pour rencontrer des amis à l’entrée, ‘’c’était aussi des moments de retrouvailles’’, précise-t-il.
Le cinéma avait fini de transformer certaines personnes en danseurs ou chanteurs à force d’imiter des acteurs de films Hindous, d’après Falla, également acteur culturel.
Amadou Issa Kane, journaliste natif de la commune de Matam garde intact ses souvenirs de jeune féru de cinéma.
Pour lui, les films joués par Bruce Lee (l’un des plus grands acteurs de Kung Fu sino-américain) ou Hindous étaient ses préférés. Quand il y avait des bagarres à l’entrée, il patientait avec ses amis ‘’jusqu’à ce que le calme revienne pour se faufiler et entrer dans la salle munis d’un sachet de crème glacée ou de biscuit’’ en faisant comme s’ils étaient sortis au moment de l’attroupement.
‘’Souvent, on entendait des cris et des insultes surtout quand le projectionniste commettait l’erreur de sauter une étape du film. Le lendemain on se plaisait de raconter à nos camarades qui n’y étaient pas ce qui s’est passé au cinéma’’, dit-il.
Comme Falla, le correspondant de Walfadjri aussi allait chercher du bois mort qu’il vendait pour acheter un ticket d’entrée.
L’enseignant Abou Diaw indique que le plus intéressant était les affiches qu’on mettait à l’angle Fadel le matin, avant d’aller chercher de l’argent pour acheter le ticket d’entrée.
Il se souvient avoir beaucoup suivi des films de Thug Norris ou Bruce Lee. Hamady Sy, un vieux comédien travaillant pour la famille Fadel, faisait le tour avec beaucoup d’humour pour faire la publicité de l’affiche de la nuit.
‘’Il se rendait jusqu’à Ourossogui à bord d’une voiture sonorisée pour faire le même travail. A la sortie de la salle, on passait à la boulangerie d’à côté pour acheter du pain avant de rentrer à la maison. Par la suite, les prix ont été revus à la hausse avec un seul film à 100 francs, au lieu de deux avant’’, explique Diaw qui sert à Nguidjilone.
Pour lui, c’est l’avènement des cassettes-vidéos qui a contribué à la disparition de la salle de cinéma, plaidant pour la construction d’une nouvelle infrastructure cinématographique dans la commune. 
Père Chémaille, père du cinéma muet et cinéma ambulant
Bien avant la construction d’une salle de cinéma dans la ville, les Matamois suivaient déjà des films à travers le ‘’cinéma ambulant de Bakel’’. Ce promoteur quittait Bakel, dans la région de Tambacounda pour faire des projections de films à Matam, explique Abdoul Yirim Ndiaye, acteur de développement qui s’active également dans la culture.
‘’Il mettait des bâches, avec des entrées payantes dans un endroit de la ville. Au fil des années, il y a eu des évolutions avec l’arrivée d’un opérateur économique nommé Simon Obeyka, un libano-syrien qui a eu à installer un cinéma éphémère dans une maison, à l’actuel angle Fadel, ex-Petersen jusque dans les années 1975’’, ajoute cet habitant du quartier Tantadji.
D’après lui, c’est avec ce dernier que les Matamois ont commencé à voir des films sénégalais tels que ‘’Borom Sarret’’ (1963), ‘’Le Mandat’’ (1968), Guélwaar (1992) du réalisateur sénégalais Ousmane Sembene.
Le cinéma ambulant de ‘’Bakel’’ était installé au niveau de la cour du centre culturel de l’époque devenu aujourd’hui le CDEPS de Matam. En période d’hivernage, c’est la grande salle du centre qui était utilisée pour projeter des films, renseigne-t-il.
Aboul Yirim Ndiaye, étant plus jeune a été aussi témoin de l’existence du cinéma muet initié par un receveur qui, à l’aide de son appareil cinématographique mettait des films à la Poste de Matam avec des entrées payantes.
Quelques années plus tard, un religieux du nom de Père Chémaille avait installé un cinéma devant l’Eglise pour permettre aux amoureux du cinéma de regarder des films gratuitement.
‘’Avec le Père Chémaille, nous suivions des films documentaire et d’animation comme ‘’Les aventures de Tintin’’ une série de dessin animé belge. Pour le cinéma ambulant, y avait des films hindous, westerns tel que ‘’Django’’ du réalisateur Sergio Corbucci (Italo-espagnol), des Cow-boys américains’’, se rappelle Ndiaye.
Selon lui, avec des amis, ils trafiquaient des billets ou utilisaient le ticket d’un autre pour entrer dans la salle.

AT/FKS/ASB/OID