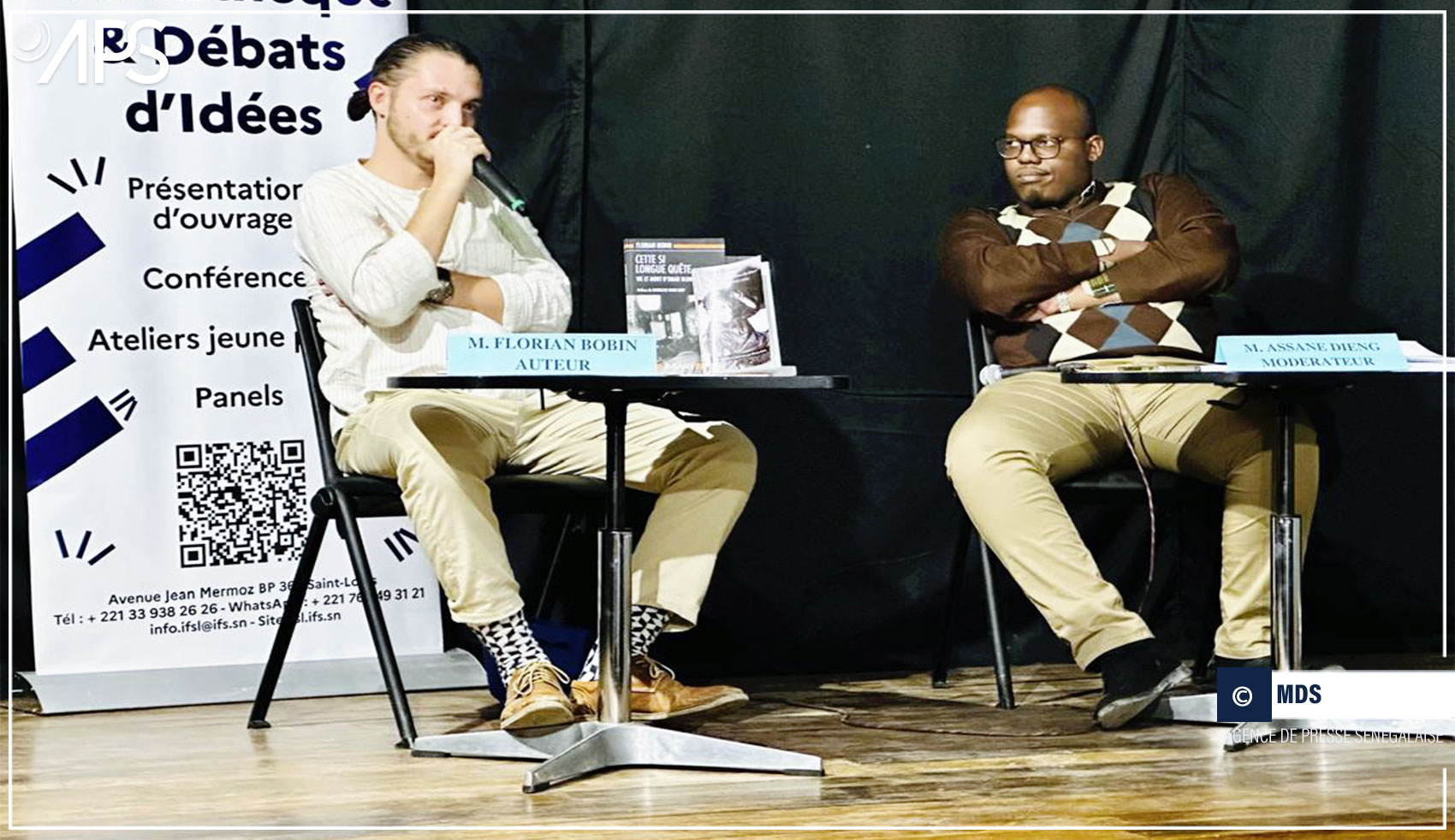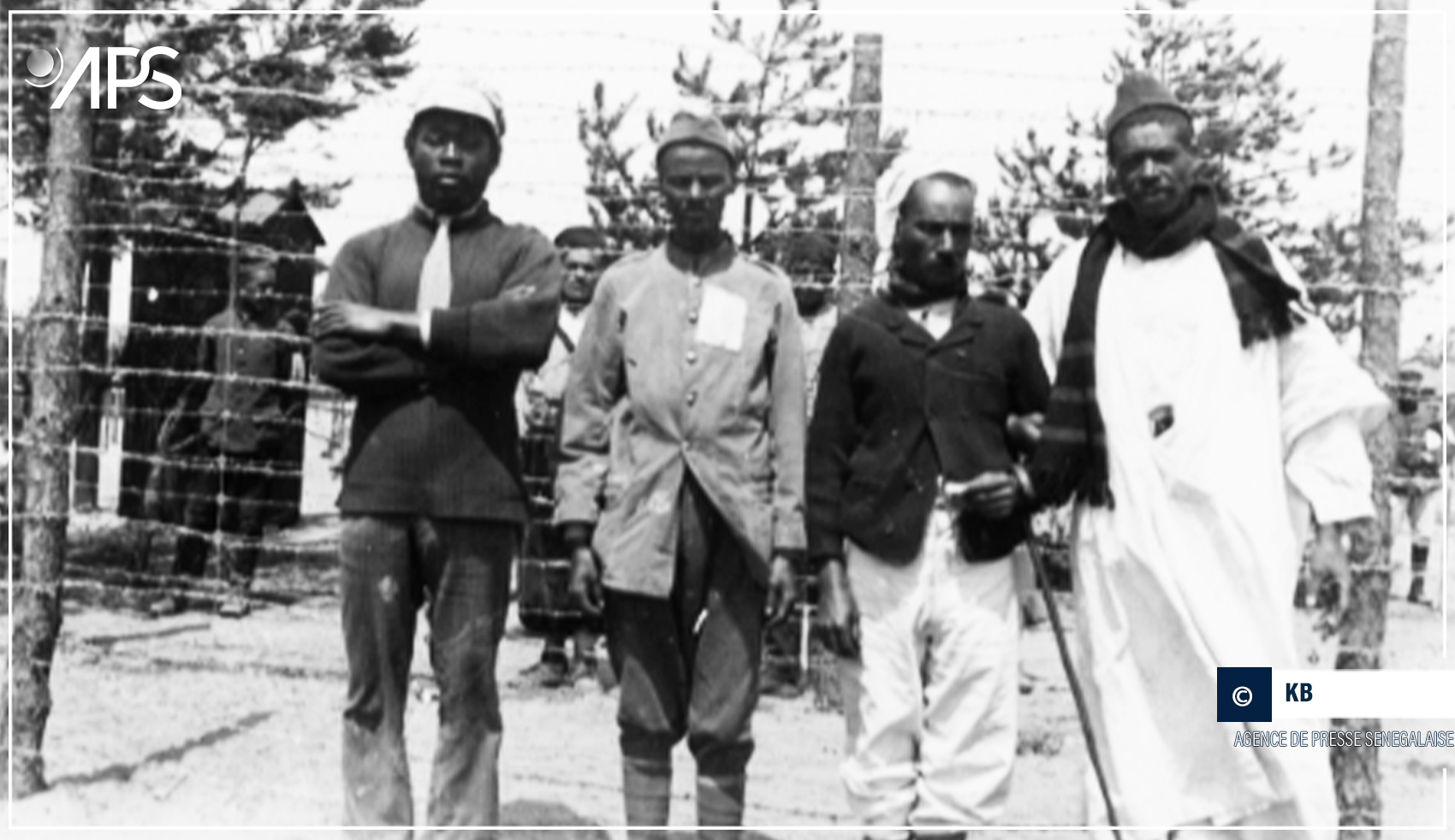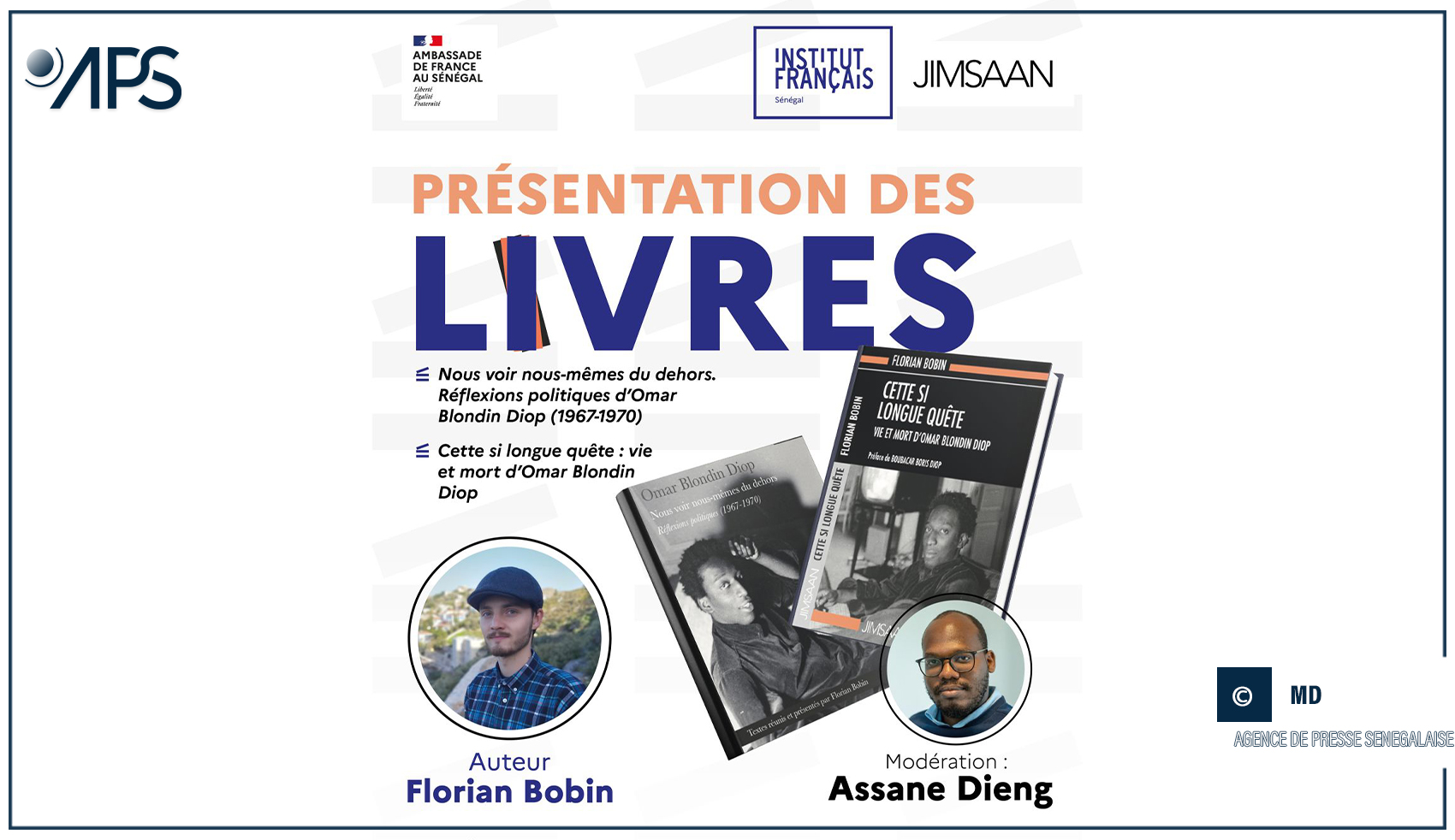Dakar, 24 mai (APS) – L’universitaire sénégalaise Fatoumata Bernadette Sonko préconise « un changement d’imaginaire social » pour mettre un terme à la « minorisation des femmes » dans la société en général, dans l’espace politique en particulier, au sein duquel la gent féminine est appelée à « mener le combat pour faire bouger les lignes ».
Une « somme de facteurs » entrave « les fragiles avancées des droits acquis par les femmes », soutient-elle dans une tribune parvenue à l’APS en pointant la perpétuation du « processus d’ostracisation des femmes non seulement depuis la ‘déterritorialisation’ occasionnée par l’arrivée des religions du Livre et la colonisation, mais aussi la poursuite de cette exclusion par les autorités sénégalaises à partir de 1960 ».
La situation est telle que « sans un changement d’imaginaire social, nommer des femmes à des postes de ‘visibilité’ ne permet pas de briser les stéréotypes solidement ancrés dans les mentalités », écrit Fatoumata Bernadette Sonko, enseignante au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), l’école de journalisme de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.
« La loi sur la parité ne bouleverse pas le système d’inégalité dénoncé et ne change pas non plus la réalité sociologique. Il ne suffit pas de changer la culture politique, mais les soubassements de pratiques culturelles qui les marginalisent », fait-elle observer.
« Il urge, donc, de s’attaquer aux fondements des structures sociales basées sur des privilèges et des curricula masculins », écrit cette enseignante-chercheure en médias et genre, auteure de plusieurs ouvrages, dont « Femmes sous silence au Sénégal. Une fabrique du patriarcat » (éditions L’Harmattan).
Fatoumata Bernadette Sonko fait état d’un « sevrage brutal, suivi d’un régime draconien, digne d’un ‘programme d’ajustement structurel’ au féminin », concernant la sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles au Sénégal.
Elle cite en exemple le nouveau gouvernement, dans lequel siègent quatre femmes sur 30 ministres, soit 13 % pour 49,6 % de la population, la même tendance s’observant, dit-elle, « avec les nominations hebdomadaires du Conseil des ministres pour les principaux postes décisionnels ».
L’idéologie patriarcale « a servi de pivot à la politique coloniale »
« Au-delà de l’indignation collective, cette minorisation des femmes interpelle et fait réfléchir sur ses origines, la construction idéologique qui la sous-tend et ses structures de légitimation », analyse l’enseignante au Cesti, ajoutant que l’État colonial, en plus des dégâts imputables au patriarcat, a contribué à imposer l’hégémonie masculine et à déposséder les femmes, notamment par la loi foncière de 1904.
Dans le même ordre d’idées, « l’École normale des filles [de Rufisque] n’a été mise en place qu’en 1938, vingt ans après celle des garçons, pour les initier à des métiers subalternes. Pour mieux écarter les femmes de la vie politique décisionnelle, insiste-t-elle, l’administration coloniale a ostensiblement ignoré leur pouvoir traditionnel, leurs chefferies et leurs prêtrises ».
Il en résulte que l’idéologie patriarcale « a servi de pivot à la politique coloniale et à ses relations avec les différentes aristocraties locales, puis avec les milieux maraboutiques ».
Les Sénégalaises n’ont pas vu leur situation changer non plus avec l’indépendance du pays en 1960, les nouvelles autorités héritant « des valeurs infériorisant les femmes », les perpétuant « à travers les institutions et prolongeant le ‘contrat social sénégalais’ – expression que nous empruntons à Donal Cruise O’Brien – avec les chefs confrériques ».
Le Code de la famille, entré en vigueur en 1972, « ne fait que cristalliser l’assujettissement des femmes. L’essentiel de ses dispositions leur sont défavorables », observe l’enseignante-chercheure.
« La socialisation différenciée par une stratification liée au sexe fabrique des attentes différentes. Les filles sont éduquées à rendre service aux autres et à conjuguer au quotidien les verbes ‘plaire, avoir et satisfaire’, des PAS à assimiler systématiquement pour entrer dans le schéma social et œuvrer pour leur réussite conjugale », écrit Fatoumata Bernadette Sonko.
Les filles « doivent se prévaloir d’une ‘langue courte’ renvoyant à un silence construit et validé par la société, avoir des ‘pas courts’ pour ne franchir l’espace assigné qu’avec une autorisation masculine, et un ‘regard court’ qui ne questionne pas les fondements de leur subordination. Étroitement surveillées, elles subissent, à chaque étape de leur vie, les contrôles d’une société panoptique, au sens foucaldien. Une surveillance qui contraste avec celle des garçons encouragés à monopoliser l’espace, à le conquérir, à y bâtir et conserver leur réussite professionnelle », analyse-t-elle.
« Les femmes doivent être au cœur du ‘Projet’ »
L’école, « une passerelle qu’empruntent plusieurs générations », y va également de son influence négative en excluant les femmes des pages de l’histoire ». La toponymie, « qui reflète une reconnaissance symbolique, immortalise les hommes et enterre les femmes. Masculine et coloniale, elle les efface de notre mémoire collective ».
Il y a aussi les représentations véhiculées par les médias qui « accordent plus de visibilité et de poids aux hommes », sous la forme d’un « miroir déformé, qui n’est qu’une réplique réflexive de la configuration sociale », contribuant à renforcer « l’invisibilité et l’inaudibilité des femmes » dans les sphères décisionnelles.
Or, fait valoir Fatoumata Bernadette Sonko, « la rupture prônée par le gouvernement, qui met l’accent sur le bien-être social de tous les Sénégalais, commence par la famille et dans la famille », dont les femmes « constituent le socle, le ‘poteau mitan’ ».
« Pour atteindre ce bien-être, [les femmes] doivent être au cœur du ‘Projet’ de développement économique et social des nouvelles autorités », indique l’enseignante-chercheure, estimant que cette question doit être analysée au-delà du clivage sur le débat sémantique sur l’appellation du ministère de la Famille, à la place du ministère de la Femme.
« Il doit aller au-delà de ce clivage pour apporter des réponses diversifiées et conjuguées aux préoccupations quotidiennes de toutes les femmes comme la sécurité, l’adaptabilité des services publics et du transport en commun, l’accès au foncier et au crédit, l’encadrement du travail des employées domestiques, la prise en charge par l’État des traitements de fertilité pour les couples en difficulté de procréation, les congés de maternité pour toutes, etc. »
De la même manière, la « redéfinition des luttes à partir d’un schéma endogène est une priorité pour éviter le piège d’un féminisme médiatique communiquant à tout-va, un féminisme sans boussole ni colonne vertébrale qui emprisonne les femmes ».
Tout cela pour dire que le rapport au pouvoir des femmes « ne doit pas se résumer en une énumération quantitative de leur présence dans les instances décisionnelles ou se limiter à la parité en termes de représentativité politique ».
« La sous-représentation des femmes, qui régit tous les compartiments de la vie sociale, au-delà d’un sémantisme construit, n’est qu’un continuum », assène Fatoumata Bernadette Sonko.
Elle estime que cette question « est politique et l’engagement politique en est l’antidote ». « C’est dans l’arène politique, lieu d’exercice du pouvoir, que les femmes doivent mener le combat pour faire bouger les lignes, s’en approprier comme un lieu de libération, malgré le coût social élevé du billet d’entrée, refuser de servir ‘d’escaliers’ aux hommes et assumer leur leadership au lieu d’attendre des substituts de reconnaissance pour se débarrasser de leur ‘mussoor de verre’. »
BK/ESF