Par Baboucar Thiam
Thiès, 24 fév (APS) – Les eaux usées, habituellement considérées comme un problème d’assainissement dont la mauvaise prise en charge impacte durablement le cadre de vie, révèlent leur grand potentiel dédié à la valorisation de l’horticulture dans les faubourgs de la commune de Thiès (ouest), plombé par le déficit pluviométrique lié au changement climatique.
Les pouvoirs publics ont installé plusieurs stations de traitement dans la région, dont une à Keur Saïb Ndoye, dans les faubourgs de la cité du rail. Non loin de cette station, plus d’une centaine de maraîchers ont décidé de transformer en opportunité les problèmes d’assainissement courants des villes. Ils utilisent les eaux usées recyclées par cette station pour développer une agriculture sans engrais chimiques.
A l’entrée de la station de Keur Saïb, à la lisière de Médina Fall, un quartier de la commune de Thiès Nord, se dresse un grand bassin surplombé d’une structure métallique, dont la rouille commence à ternir la peinture bleue.
Cette station est fortement sollicitée pour le traitement des eaux usées issues des fosses septiques et du système d’assainissement de la ville de Thiès et ses environs.
‘’Il faut savoir que c’est la seule station d’épuration de la ville de Thiès’’, précise Amath Ndiaye, en charge de la gestion de cette installation chargée du traitement des eaux usées des ménages de Thiès et environs, acheminées ici par des camions-citernes, mais aussi via le réseau de drainage.
Les eaux arrivent à cette station ‘’chargée de matières solides, de sable, de sachets plastiques et autres ordures ménagères, en plus de l’huile qu’elles contiennent’’, détaille le responsable de la station d’épuration, la trentaine révolue.
«
Le recyclage effectué par cette station nécessite l’utilisation de méthodes mécaniques, telles que la filtration et la décantation, ainsi que de méthodes biologiques et chimiques. Les eaux dont ont été extirpés les déchets solides, la graisse et le sable ‘’contiennent des matières fécales dissoutes, qui seront enlevées par un traitement biologique qu’elles subiront en dernier ressort dans des bassins’’, a-t-il signalé.

Le processus d’épuration supervisé par un laborantin
Cette opération appelée ‘’traitement tertiaire’’ est exécutée par des bactéries vivant dans des bassins dits biologiques, dans lesquels ces organismes microscopiques se nourrissent et se reproduisent aussi.
Il s’agit de bassins relativement profonds dans lesquels ces bactéries se gavent des matières fécales dissoutes dans un liquide à l’aspect répulsif, malodorant du fait qu’il provient des égouts et des fosses septiques.
Au besoin, la contenance des bassins peut être désinfectée en utilisant du chlore. Cette eau chlorée peut servir dans les travaux publics (construction routière, bâtiment). Mais parfois, elle n’a pas besoin d’être chlorée, car ayant été débarrassée de ses matières fécales et substances nuisibles, après l’intervention des bactéries.
Cette eau reste riche en phosphore et en azote, deux puissants fertilisants, et ‘’est très prisée par les maraîchers, les arboriculteurs et les horticulteurs qui l’utilisent pour arroser leurs plantes’’, renseigne le responsable de la station.
Tout le processus d’épuration est supervisé par un laborantin, qui effectue des prélèvements à toutes les étapes, pour ‘’s’assurer que l’eau qui sort de la station est totalement purifiée et est réutilisable pour l’agriculture ou rejetée dans la nature, sans risque’’.

Comme pour rassurer, le responsable du laboratoire de contrôle de la station de Thiès, El Hadj Cissé montre trois bocaux contenant des échantillons d’eau de couleur noire, d’aspect plus clair et enfin de couleur jaunâtre. Ils représentent les trois états successifs des eaux usées, de leur arrivée en provenance du système d’assainissement ou des camions-citernes à la fin du processus d’épuration.
‘’Ici, nous avons les trois échantillons que nous avons analysés au niveau du laboratoire, donc nous connaissons exactement la composition physico-chimique des eaux qui arrivent et qui sortent de cette station, afin de respecter les normes de rejet de l’ONAS et du Sénégal’’, assure-t-il, ajoutant que des normes sont fixées pour chaque paramètre.
Des ‘’lits de séchage’’ pour traiter la boue issue des eaux usées
Après l’activité des bactéries, l’eau noirâtre, passée par le clarificateur, devient jaunâtre. Ce liquide, appelé ‘’eau clarifiée’’, subit une analyse visant à vérifier d’abord le respect, à cette étape, des normes de conception de l’usine de Keur Saïb Ndoye, ensuite, celui des normes de rejet sénégalaises.
Avant tout rejet des eaux déjà traitées, quelques-uns de leurs paramètres sont nécessairement mesurés, afin de s’assurer qu’elles respectent les normes sénégalaises. Il s’agit du potentiel hydrique (PH), de la demande biochimique en oxygène (DBO), de la demande chimique en oxygène (DCO) et des matières en suspension.
‘’Tous ces paramètres sont analysés à partir des eaux qui sortent complètement de la station d’épuration’’, insiste le laborantin. Pour traiter la boue issue des eaux provenant du système d’assainissement et des fosses septiques, la station est dotée de ‘’lits de séchage’’.
Les eaux boueuses sont drainées vers l’épaississeur, après quoi elles sont acheminées dans les lits de séchage munis de drains superposés en profondeur, découpés pour favoriser l’infiltration des eaux qu’elles contiennent.
Une fois asséchée dans les bassins pendant 30 jours, ‘’cette boue est d’abord broyée, réduite en poudre, mise en sac et distribuée aux cultivateurs, maraîchers, horticulteurs, arboriculteurs et autres producteurs agricoles de la zone pour servir de fertilisant ‘’, indique le gérant de la station d’épuration de Tivaouane, Lamine Diop.

Elle peut aussi être utilisée dans la fabrication de pavés, dit-il. De fait, face à la baisse des rendements des terres agricoles et la prolifération des fertilisants chimiques, qui constituent un danger pour l’environnement et la santé, la boue issue du traitement des eaux usées peut représenter une alternative pour fertiliser les terres, tout en contribuant à préserver l’environnement.
Dans cette optique, la station alimente en eau et en fertilisants des producteurs actifs dans les périmètres maraîchers de la zone. Au bout de plus d’une dizaine de minutes de marche sur une route latéritique, jonchée de nids de poules, apparaît une longue clôture en fils barbelés, surmontée de plantes rampantes. Une allée débouche là sur des périmètres maraîchers.
Des périmètres exploités 12 mois sur 12
Le site abrite aussi une vaste lagune où sont déversées les eaux déjà traitées pouvant être utilisées pour le maraîchage. Un endroit captivant de par sa verdure. Un bosquet luxuriant entourant une étendue d’eau claire sur laquelle s’étalent à perte de vue de belles fleurs de nénuphars : c’est la lagune recevant les eaux traitées à leur sortie de la station d’épuration, à laquelle elle est directement connectée par des tuyaux d’évacuation. Rien, à première vue, ne peut laisser croire que cette eau vient des fosses septiques et du système d’assainissement de Thiès.
L’espace abrite des périmètres maraîchers, des arbres fruitiers, mais également une grande variété de végétaux sauvages. Preuve du caractère fertilisant de l’eau déversée dans la lagune, l’environnement immédiat, telle une oasis, contraste nettement avec le reste du paysage à la ronde. ‘’Cette eau nous aide beaucoup’’, confie Moundiaye Diogoye, un jeune maraîcher dont l’activité dépend de cette eau.
Le jeune homme informe que grâce à cette lagune, bon nombre de maraîchers exploitent ici des parcelles 12 mois sur 12. ‘’Tous les travailleurs que vous voyez ici, plus d’une centaine, utilisent l’eau recyclée qui vient de l’usine’’, renseigne Diogoye.

En cette période post-hivernale coïncidant avec la saison froide, l’activité horticole bat son plein. Les parcelles sont épanouies. Différentes variétés de légumes sont produites dans ces périmètres arrosés et fertilisés avec des eaux et de la boue sorties droit de la station de Keur Saïb Ndoye.
L’engrais et l’eau que nous utilisons, nous viennent de la station, note Diogoye, un horticulteur habitant Médina Fall, un quartier adjacent de Keur Saïb Ndoye. ‘’Actuellement, nous recrutons beaucoup de saisonniers qui nous viennent de l’intérieur du pays : Kaolack, Fouta, mais également de la zone des Niayes’’, affirme le jeune producteur.
Boues de vidange aussi efficaces que les engrais minéraux
Selon le conseiller technique du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Mouhamadou Guèye, ces maraîchers démontrent, par la pratique, que les eaux usées traitées et les produits dérivés comme la boue, ont un pouvoir fertilisant, avec un avantage supplémentaire : leur utilisation ne pollue pas les terres et les nappes phréatiques.
‘’C’est cela qu’il faut promouvoir, afin d’avoir une agriculture biologique, une agriculture qui préserve l’environnement, bref une agriculture durable’’, recommande-t-il, en rappelant que les engrais minéraux contiennent des substances contribuant au lessivage de nos terres et à créer ainsi une baisse des rendements agricoles.
Il préconise donc l’utilisation de cet engrais biologique comme un moyen de préservation de l’environnement et, dans une certaine mesure, comme un outil d’adaptation au changement climatique. ‘’Il faut promouvoir l’utilisation de ces engrais’’, insiste le conseiller technique, laissant entendre que le contexte s’y prête, d’autant que l’Etat du Sénégal autorise et encourage même désormais l’utilisation de l’engrais organique. Ce qui, selon lui, n’était pas le cas il y a quelques années.

Il fait savoir qu’il y a ‘’plus d’une quinzaine de stations de traitement de boue de vidange’’ au Sénégal, dans lesquelles les eaux issues des fosses septiques sont collectées, traitées et valorisées en boue séchée pour l’agriculture, avec l’utilisation d’omniprocesseurs permettant de transformer les boues de vidange en eau distillée et en cendres pour formuler de l’engrais organo-minéral destiné à l’agriculture.
Le technicien soutient que des tests réalisés par des laboratoires de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ont montré que ces boues peuvent être utilisées directement, ‘’sans influence néfaste, sur les terres et sur les cultures, avec un pouvoir fertilisant aussi bon que celui des engrais minéraux et sans effet néfaste sur l’environnement’’.
De même, il affirme qu’une étude de l’USAID, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, a montré qu’on peut augmenter de 32 fois le potentiel de traitement des boues de vidange au Sénégal.
‘’Nous avons encore 32 fois [plus] de marge d’augmentation de ce potentiel, la valorisation des boues de vidange et des produits issus de l’assainissement n’a pas encore atteint sa maturité, nous n’en sommes qu’au début’’, avance-t-il.
Les maraîchers ont remarqué un autre avantage : c’est que les productions obtenues à partir de l’eau et des produits dérivés du traitement des boues de vidange, se conservent plus longtemps.
BT/ADI/BK/ASB/OID/ASG

















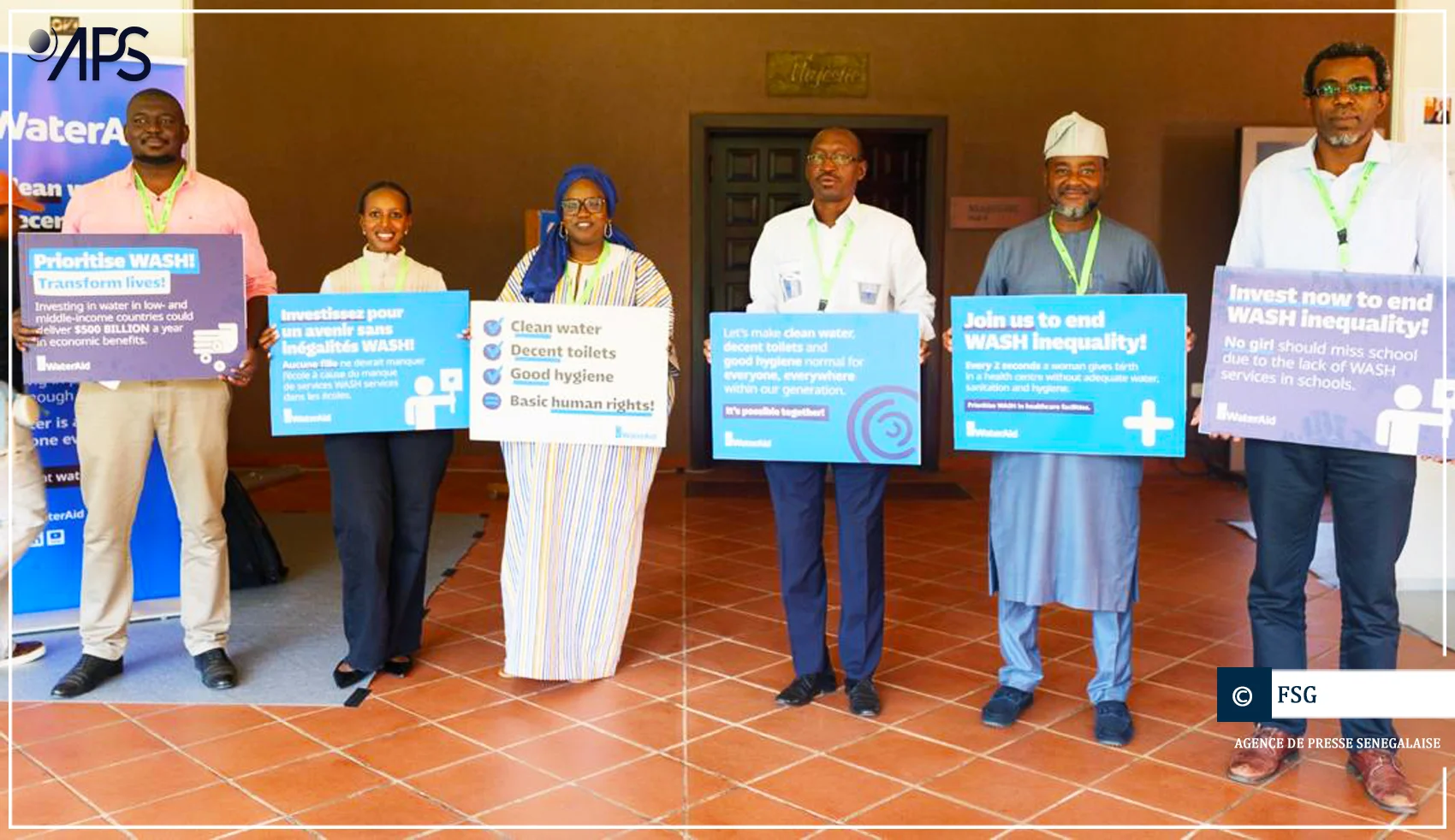





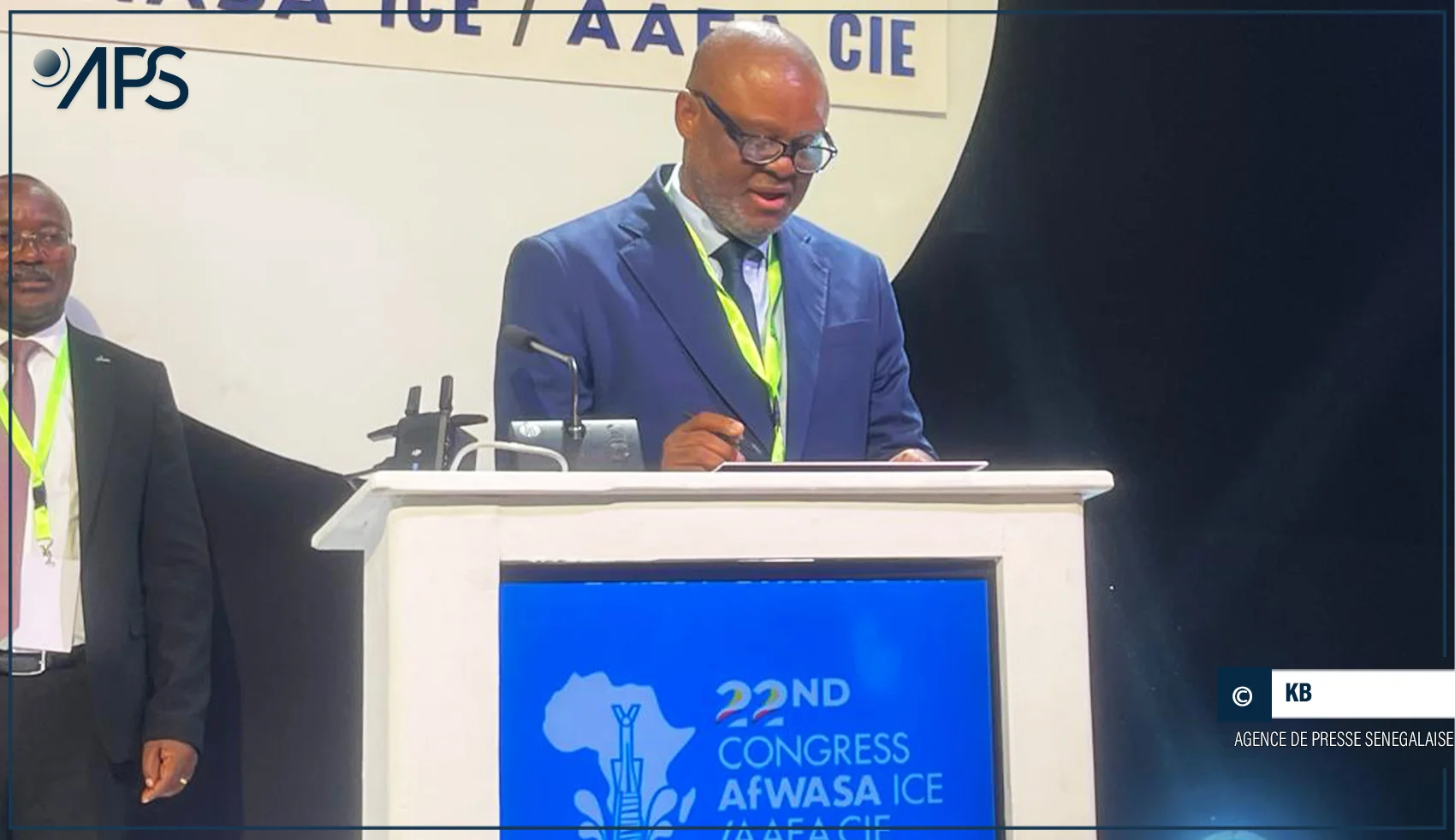
 Il a cité l’exposition par de nombreuses entreprises venues, d’Asie, d’Europe, d’Afrique et de pays Africains, de matériels d’assainissement et de distribution d’eau de dernière génération.
Il a cité l’exposition par de nombreuses entreprises venues, d’Asie, d’Europe, d’Afrique et de pays Africains, de matériels d’assainissement et de distribution d’eau de dernière génération. SG/OID
SG/OID
