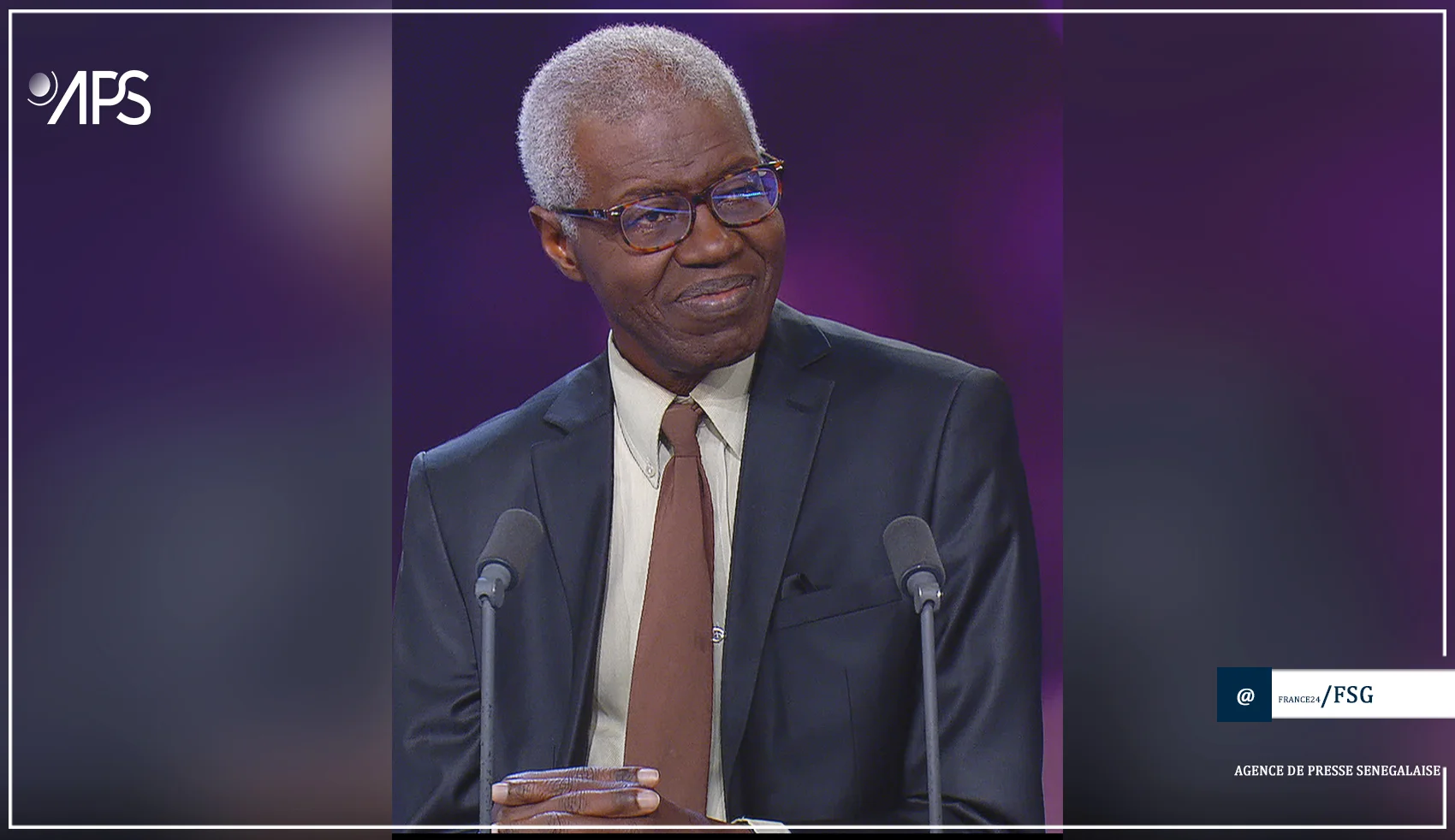Par Souleymane Faye
Dakar, 9 déc (APS) – La Foire internationale de Dakar (FIDAK) est un outil de promotion de l’intégration économique et culturelle des pays de la région, selon des exposants rencontrés à la 32e édition (28 novembre-15 décembre), qui disent y trouver une belle occasion de nouer des contacts, d’écouler des marchandises et de sceller des partenariats avec des commerçants et des artisans venus pour la plupart de pays d’Afrique de l’Ouest.
La FIDAK 2024 coïncide avec le cinquantenaire du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), l’établissement public chargé de son organisation depuis 1974.
« Il ne peut pas y avoir de FIDAK sans le Burkina Faso », jure Daniel Samandoulgou, un artisan burkinabè, s’empressant d’ajouter : « La foire de Dakar est un espace d’échanges entre les pays. Ça va au-delà du commerce, ça tisse des relations. À force de rencontrer les mêmes gens chaque année, on finit par tisser des liens avec eux », dit le jeune Burkinabè, un badge d’exposant délivré par le CICES en sautoir sur la poitrine. Cette rencontre commerciale biennale organisée depuis 1974, annualisée récemment, est un rendez-vous « des arts et de la culture », selon M. Samandoulgou.
« J’aime le Sénégal », lance Nasri Ali Bey lorsqu’on lui demande ce qu’il fait à la foire de Dakar. Assis devant une grosse table basse en marbre, l’homme, un chapeau melon vissé sur la tête, aime à se présenter comme « un Sénégalais de cœur ». Il devise joyeusement. Les relations sénégalo-algériennes n’ont pas de secret pour lui. « Ce showroom, nous l’avons loué depuis 2023 pour une durée de trois ans renouvelable. Il est là en permanence. C’est une décision du président d’Algérie, qui a fait faire la même chose à Nouakchott et à Abidjan. Prochainement, il y aura un showroom de la République algérienne à Douala », dit fièrement M. Bey, consultant en commerce international et président de l’Association nationale des exportateurs algériens.

Nasri Ali Bey, un exportateur algérien, prend part à la FIDAK.
Le showroom installé par son pays au CICES s’étend sur plusieurs centaines de mètres carrés. « L’Algérie, à l’initiative de son président, a décidé de se tourner vers l’Afrique, notre continent. C’est une orientation stratégique, qui va nous permettre de développer nos échanges avec l’Afrique en commençant par le Sénégal, la porte d’entrée du continent », dit-il doctement, s’empressant de dévier la conversation de temps en temps vers d’autres sujets, l’histoire et la politique surtout.
« La FIDAK, pour nous Algériens, est une affaire de cœur d’abord. C’est un endroit où on échange surtout des savoirs. Nous, Algériens, nous nous inscrivons dans la ZLECAf (la zone de libre-échange continentale africaine), raison pour laquelle nous avons supprimé les droits de douanes avec certains pays du continent », lance Nasri Ali Bey, tout sourire, se positionnant derrière une table ornée des drapeaux algérien et sénégalais, sous l’objectif du reporter photographe de l’APS.
« Je ne serais peut-être jamais venue au Sénégal sans la FIDAK. J’ai déjà envie de revenir aux prochaines éditions parce que cette première participation m’a permis de savoir ce dont les Sénégalais ont besoin. Ça m’a permis de nouer des contacts », s’enthousiasme la tisseuse burkinabè Abibata Zan, confortablement assise sur une chaise en plastique, au milieu d’un stand.
Comme beaucoup d’exposants de son pays, elle écoule à la foire de Dakar des produits textiles, dont les célèbres tissus Faso Dan Fani, symboles du patriotisme et du souverainisme burkinabè.

Abibata Zan fait partie de la délégation d’exposants venue du Burkina Faso.
Abibata Zan conçoit la FIDAK comme un espace d’« opportunités » et de « découvertes ». « Je vais acheter des marchandises d’ici, après la foire, pour les revendre dans mon pays », promet-elle en interpelant un passant en dioula, une langue parlée notamment en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.
Amidou Cissé accueille les visiteurs avec hospitalité, leur offrant même des fruits, dès qu’ils entrent dans son stand. Ce jeune professionnel du textile estime que « la FIDAK est un espace d’intégration des peuples ». « La foire, c’est aussi des rencontres. On y tisse des relations, on noue des partenariats. C’est un rendez-vous qui nous permet d’exceller ensemble. Ça nous rapproche davantage, les uns des autres », confie-t-il, vantant la contribution du Burkina Faso à la foire de Dakar.
« Le Burkina Faso est un pays d’artisanat. Tout est fait à la main. Avec ou sans l’aide des autorités de notre pays, nous faisons la promotion de nos produits. Tenir la FIDAK sans les Burkinabè revient à raser la tête de quelqu’un à son absence, c’est impossible », dit-il.
Les artisans de la Guinée et du Rwanda exposent dans des endroits décorés avec beaucoup de soin et de finesse. Cette année, ces deux pays sont les « invités d’honneur » de la Foire internationale de Dakar, selon la direction générale du CICES.

Dady Yomba Touré, une exposante guinéenne
« Nous avons aimé la FIDAK. C’est très intéressant. Certains de nos exposants envisagent même de venir s’installer à Dakar », dit Sandrine Mbarushimana, une jeune femme timide en apparence. Perchée sur une longue chaise, elle assure le secrétariat de la participation rwandaise à la FIDAK. « Nos artisans veulent apprendre aux jeunes Sénégalais à fabriquer des chaussures, des colliers, des tissus, etc. De Dakar, ils importent le basin, qui est très peu commercialisé au Rwanda », raconte la jeune femme, ajoutant : « C’est un grand plaisir pour notre pays et les exposants rwandais d’être choisis invités d’honneur de la FIDAK. Il y a eu, ici, une exposition internationale à l’honneur de notre pays. C’est un grand plaisir. »
« C’est une belle opportunité qui nous a été offerte par le Sénégal d’être là », se réjouit, toute souriante, la décoratrice et vendeuse de parures rwandaise Fatuma Uwaminezi.
Dady Yomba Touré fait partie des exposants guinéens de la 32e édition de la foire de Dakar. « La FIDAK est un moyen de renforcement des liens d’amitié sénégalo-guinéens et du tissu social des deux pays », sourit cette femme à la mine toute joviale, vêtue d’un boubou teint, à motifs noir et blanc.
« Hier, nous avons assisté à une belle prestation du Bembeya Jazz national, à l’occasion de la foire », raconte-t-elle en faisant allusion à un célèbre orchestre guinéen venu contribuer à l’animation culturelle de la FIDAK.

La décoratrice et vendeuse de parures rwandaise Fatuma Uwaminezi
Le cordonnier guinéen Cissé Mory estime avoir vécu une « expérience exceptionnelle » en prenant part à la foire de Dakar. « Nous avons noué beaucoup de contacts parmi les artisans sénégalais, avec ceux d’autres pays également. Nous avons pris la décision de nous revoir et de mener des activités ensemble. Nous espérons revenir aux prochaines éditions de la foire, qui est un bon moyen de partage et de promotion du commerce. Nous avons eu des échanges sur les modes de travail, les difficultés de l’artisanat, l’acquisition des matières premières… » se réjouit M. Cissé, se précipitant vers l’entrée de son stand pour l’accueil des visiteurs.
Le Malien Almoustapha Soumaré est un habitué de la FIDAK, à laquelle il participe depuis une vingtaine d’années. « La plupart de nos clients résident au Sénégal. C’est un rendez-vous important pour nous. La FIDAK, c’est de l’économie, de l’artisanat, des relations… » observe ce professionnel du textile et de l’habillement.
Abdou Hassane et Hussain Wallayat, respectivement venus du Niger et du Pakistan, trouvent l’édition 2024 de la foire morose. L’artisan nigérien dit être confronté à cette situation « depuis les trois dernières éditions de la foire ». « Mais ainsi vont le commerce et l’artisanat. La FIDAK, c’est très bien, même s’il n’y a pas beaucoup d’argent », dit-il d’une voix rauque.

Hussain Wallayat, venu du Pakistan, est un habitué de la FIDAK.
Hussain Wallayat se plaint de la faiblesse de ses ventes. « Nous ne vendons presque pas. Pourtant, nous avons beaucoup dépensé pour être là », s’alarme ce commerçant spécialisé dans la décoration haut de gamme.
Le commerçant venu de Karachi, la mine renfrognée, se souvient que « la FIDAK, c’était beaucoup d’opportunités, il y a quelques années ».
« Il y avait beaucoup d’Indiens et de Pakistanais. Ça ne marche plus comme auparavant. Les visiteurs disent qu’ils n’ont pas d’argent », s’inquiète Mohammad Shuaib Saifi, un commerçant indien. L’homme à la fine moustache a découvert la FIDAK en 2006 et n’y était plus revenu pendant plusieurs années, à la suite d’un incendie dont il a été victime sur le site des expositions en 2015. « Je n’ai pas été indemnisé », se désole-t-il, jugeant très élevés les droits de douane payés cette année à son arrivée à Dakar pour la foire. Un million six cent mille francs CFA, répond-il amèrement à la question de savoir combien il a payé aux douaniers.
ESF/ASG/BK