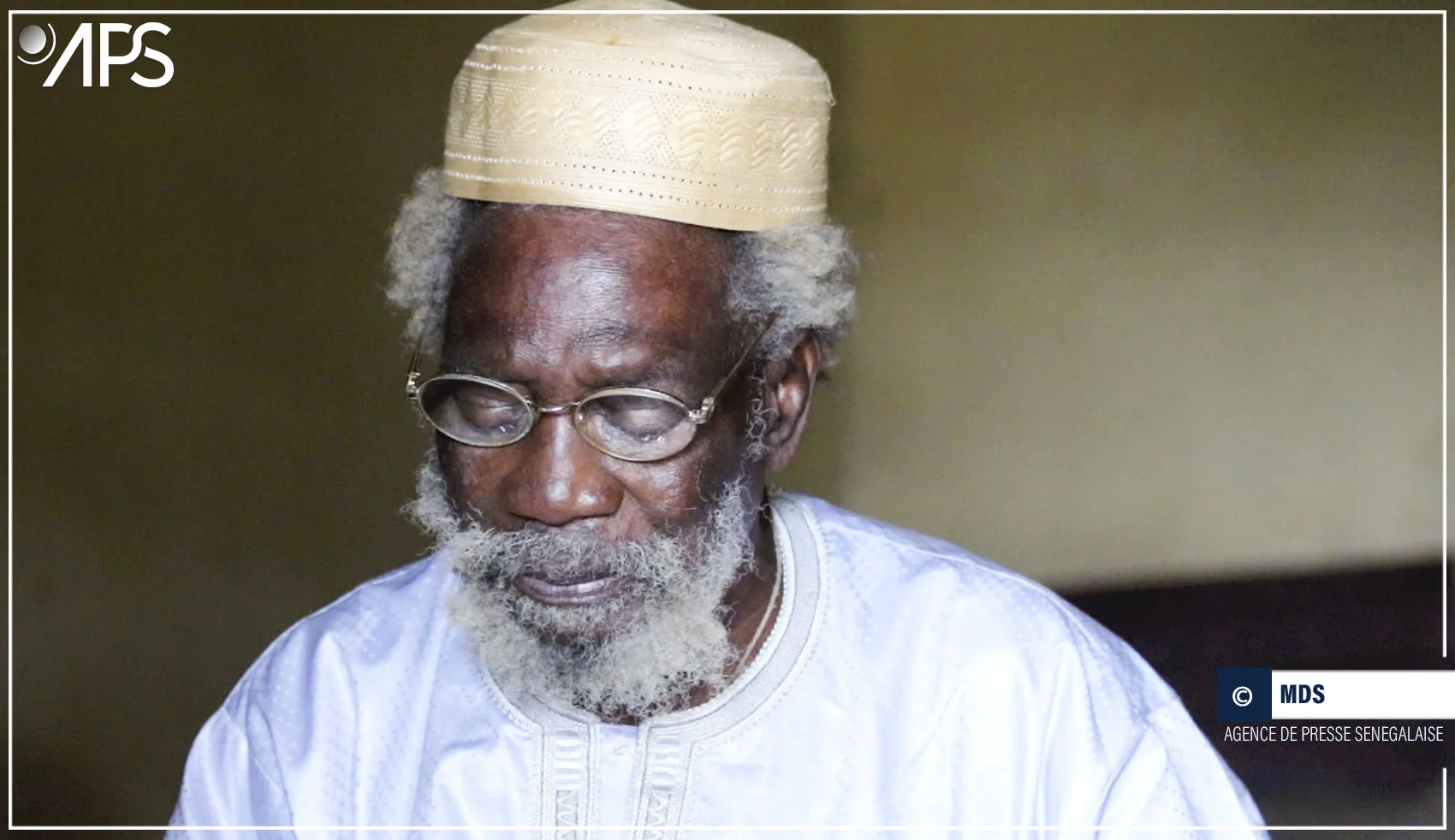Par Assane Dème
Kaolack, 28 déc (APS) – A Kaolack (centre), comme dans d’autres villes du Sénégal, les marchés, véritables pôles d’attraction, sont devenus, au fil des années, des lieux de transactions à haut risque pour les usagers, à cause des nombreux branchements électriques clandestins ne respectant aucune norme de sécurité.
Dans tous les marchés de la commune de Kaolack, des branchements électriques dont la plupart ne respecte aucune norme de sécurité sont légion. Une situation qui fait courir de grands risques aux usagers.
En cette période des fêtes de fin d’année où affluent les clients, le décor montre aisément une idée de la situation. Partout, des fils noirs surplombent les allées et les cantines.
L’ancienne capitale du Sine-Saloum, sise à 192 km de Dakar, était jadis la plaque tournante du commerce de l’arachide et du sel. Elle occupe en effet une position de carrefour, avec les routes nationales 1 et 4 qui la traversent.
La ville dispose d’un des marchés les plus pittoresques du Sénégal. Celui-ci est situé en plein centre-ville, à quelques encablures de la plupart des établissements financiers et autres services stratégiques.
A Kaolack, les marchés accueillent une bonne partie des acteurs du secteur informel composés essentiellement de commerçants, de marchands tabliers et/ou ambulants, de couturiers, de gérants de salons de coiffure, de services de transfert d’argent, de cordonneries, de bijouteries.
Mais, le marché central et les autres lieux de commerce sont exposés à des risques liés aux branchements électriques anarchiques et à la vétusté des cantines et autres magasins.
Il y a une semaine, un incendie s’est déclaré au ‘’marché Guedj’’, ravageant plusieurs dizaines de cantines, aucune perte en vie humaine n’étant cependant à déplorer.
Prolifération de branchements anarchiques
Au marché central situé en centre-ville, pas besoin de fouiner pour dénicher des branchements anarchiques, visibles à l’œil nu, presque partout.

Pour effrayante qu’elle paraisse, cette situation ne semble guère émouvoir certains des occupants interrogés par l’APS.
Assise devant sa cantine de produits cosmétiques installée depuis 2017, Ndiaya Seck a le sourire aux lèvres.
»Je reconnais qu’il y a un danger qui nous guette avec ces fils au-dessus de nos têtes », consent-elle à dire.
‘’J’avoue que cette situation me fait vraiment peur parce que les gens, apparemment, ne prennent pas conscience du danger que constituent les branchements anarchiques. Et pourtant, on a eu plusieurs occasions de nous remettre en cause, puisque les incendies sont récurrents dans ce marché’’, souligne-t-elle.
Non loin la cantine de Ndiaya Seck, Mbaye Thiam tient un atelier de couture. Entouré de ses apprentis et autres clients, il pointe du doigt la responsabilité des autorités administratives et territoriales qui, d’après lui, doivent ‘’faire preuve de rigueur’’ pour lutter contre les branchements anarchiques.
‘’L’électricité est tellement complexe qu’aucune personne ne doit jouer avec. Rien ne doit empêcher une personne responsable de tenir compte de la gravité de ce type de branchements qui menacent la vie des gens. Parce que, en cas de problème, personne n’est à l’abri’’, insiste Thiam.
Fatou Dieng, une cliente venue en quête d’huile de palme, ne décolère pas contre cette situation. Elle soutient que les responsabilités sont partagées.
En cas de sinistre, il est très difficile, voire impossible pour les secouristes de se frayer un passage afin de sauver ce qui pourrait l’être.
‘’Nous ne devons pas accepter que le Sénégal soit considéré comme une anarchie où chaque individu peut faire ce que bon lui semble. Il faut que des mesures drastiques soit prises pour éradiquer ces branchements clandestins et anarchiques’’, martèle Fatou Dieng.

Aider à moderniser le marché central
Le délégué principal du marché central de Kaolack, Lamine Ndao, appelle les autorités administratives et municipales à accompagner les commerçants dans la modernisation de leur marché.
Les autorités doivent, ‘’très rapidement’’, prendre des mesures allant dans le sens de reprendre les installations, et de mettre en place un véritable programme de modernisation des marchés du Sénégal.
Ce qu’il faut, selon elle, c’est de mettre un terme aux incendies qui pourraient causer des pertes en vie humaine.
‘’A mon avis, ces incendies dans les marchés du Sénégal sont causés par des courts-circuits et cette responsabilité est partagée. Dix cantines peuvent se partager un seul compteur, alors que dans la demande formulée (…), le matériel qui consomme l’électricité n’y figure pas’’, fait-il savoir.
En plus, renseigne le délégué principal du marché central de Kaolack, ‘’les fils utilisés dans les installations clandestines ne sont pas de bonne qualité’’. S’ils chauffent, dit-il, ils ‘’cèdent et occasionnent un court-circuit avec tout son lot de dangers’’.

Il plaide pour l’ »interdiction stricte’’ de tout partage de compteur électrique. Il suggère à la SENELEC de procéder à un ‘’contrôle’’ de nature à ‘’dissuader les mauvaises pratiques’’.
Il précise que le marché central de Kaolack abrite ‘’plus de cinq mille cantines’’.
Il appelle les parties prenantes, notamment les autorités municipales, à des ‘’concertations participatives et inclusives’’
Un milliard de pertes lors de l’incendie du ‘’marché Guedj’’
La coordonnatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM), Rougui Aladji Sow, estime à ‘’plus d’un milliard de francs CFA’’ les pertes de marchandises, causées par l’incendie du ‘’marché Guedj’’ de Kaolack.
Les ‘’facteurs qui déclenchent les incendies doivent pousser plus d’un à s’interroger sur nos responsabilités et nos comportements par rapport aux marchés’’, a-t-elle déclaré lors d’une visite à Kaolack.
Mme Sow était venue s’enquérir de la situation, en présence du préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, et des autorités municipales.

Selon elle, » les occupations anarchiques au niveau des marchés, la promiscuité, la saturation, les branchements hors-normes sont propices à déclencher des incendies et leur propagation ».
La coordonnatrice du PRMOGEM a souligné l’urgence de trouver un consensus autour de la gestion des marchés à travers des échanges et autres concertations, car, a-t-elle dit, »ces infrastructures commerciales constituent le cœur battant des communautés où l’action citoyenne et les règles qui en sont édictées doivent être observées scrupuleusement’’.
Affirmant que le PROMOGEM est le ‘’catalyseur du développement économique environnemental et social de telles infrastructures’’, Rougui Aladji Sow s’est engagée à faciliter le plan de relogement des sinistrés du ‘’marché Guedj’’ et leur accès à des financements auprès respectivement de différents programmes dédiés de l’Etat du Sénégal.
Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, parti au chevet des sinistrés du ‘’marché Guedj’’, a appelé les pouvoirs publics à s’occuper davantage des marchés pour éviter ce genre de situations.
‘’Nous lançons un appel au gouvernement du Sénégal pour s’occuper des marchés, car sur le budget du pays, qui se chiffre à plus de 6 000 milliards de francs CFA, une bonne partie provient des marchés et autres lieux de transactions commerciales. Il est temps de s’occuper des marchés’’, a-t-il plaidé.
 M. Mboup a annoncé qu’une commission sera mise en place dans les plus brefs délais pour recenser les sinistrés. Il s’agit de voir ce que la mairie et l’Etat pourraient faire en leur faveur. Selon lui, une enveloppe de 50 millions de francs CFA sera dégagée par la municipalité de Kaolack, en appui à ces sinistrés.
M. Mboup a annoncé qu’une commission sera mise en place dans les plus brefs délais pour recenser les sinistrés. Il s’agit de voir ce que la mairie et l’Etat pourraient faire en leur faveur. Selon lui, une enveloppe de 50 millions de francs CFA sera dégagée par la municipalité de Kaolack, en appui à ces sinistrés.
Un plan d’actions pour tous les marchés à risque
Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, avait saisi l’ensemble des autorités administratives du pays pour l’élaboration d’une feuille de route pour la sécurisation des marchés, a rappelé le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye.
‘’Nous avons déjà élaboré le plan d’actions qu’on compte mettre en œuvre et qui concerne tous les marchés à risque dans la commune de Kaolack’’, a signalé M. Ndiaye. Il inclut la libération des voies d’accès aux marchés, a-t-il indiqué.
‘’Ce plan d’actions va prendre en compte la question de l’électricité et d’autres activités qui ne doivent pas se dérouler à l’intérieur des marchés. Ce sont ces visites qui vont permettre de faire l’état des lieux, identifier les risques et proposer des solutions’’, assure le chef de l’exécutif départemental.
Il a également évoqué l’exécution d’un volet formation et sensibilisation sur l’utilisation des moyens de secours, les comportements à risque, ainsi que l’élaboration d’un règlement intérieur pour l’ensemble des marchés.
Un autre volet concerne la sensibilisation des Sénégalais sur l’importance de souscrire à une assurance incendie.



ADE/SKS/ASB/FKS/ASG