De l’envoyé spécial de l’APS, Abdoulaye Diallo
Louguéré Diabi (Podor), 15 mai (APS) – Les éleveurs de Louguéré Diabi, un village situé à 30 kilomètres de la commune d’Aéré Lao, dans la région de Saint-Louis (nord), vivent avec l’espoir de meilleures conditions de vie depuis la mise en service d’un forage construit par le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC).
Ce village perdu dans la zone semi-désertique du Ferlo, dans le département de Podor, est très enclavé. Il est traversé par une piste sablonneuse.
Le vent chaud et sec qui souffle dans cette partie nord du Sénégal est un signe de l’évidente dégradation de la situation du paysage en survie, qui se résume à quelques feuillages et arbustes.
Après près d’une heure de route pour rallier le village, Louguéré Diabi se découvre enfin, enveloppé dans une vague de chaleur amplifiée par un soleil encore haut dans le ciel en cette mi-journée.
Le forage de Louguéré Diabi, une aubaine pour les éleveurs et leur cheptel
Assis sur des nattes, les habitants du village s’adonnent au rituel du thé à l’ombre de petites tentes. Certains, un peu surpris ou intrigués, se redressent discrètement à la vue des visiteurs. Un petit silence s’installe. Puis c’est les salutations d’usage, pendant que les enfants, curieux plus qu’intimidés, jettent des regards furtifs au personnel du PUDC.
En saison sèche, le manque d’eau et de pâturages rend le bétail très vulnérable, dans ce village situé à une cinquantaine de kilomètres de la frontière sénégalo-mauritanienne.
Pour répondre aux doléances des éleveurs de cette localité et favoriser le développement du pastoralisme dans la zone, l’État du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC, y a construit un forage.

Selon les données techniques fournies par ce programme, le forage de Louguéré Diabi dispose d’un débit d’exploitation de 50 mètres cubes et d’un château d’eau d’une capacité de 150 mètres cubes. L’infrastructure est également dotée de 12 fontaines et de deux abreuvoirs.
Depuis la construction de cette infrastructure hydraulique destinée à 10 localités, Louguéré Diabi est devenu le carrefour des villages environnants, le point de chute et de passage aussi de nombreux éleveurs transhumants.
D’après les estimations des gestionnaires du forage, ce sont des milliers de vaches, de moutons, de chèvres, d’ânes et de chevaux qui viennent s’y abreuver chaque jour, surtout en saison sèche, un moment où les éleveurs transhumants quittent leurs terres à la recherche de pâturages verts.
Abdou Diallo, l’un des gestionnaires du forage, signale que chaque éleveur débourse 200 francs CFA par mois et par bovin en guise de participation au fonds de roulement de l’ouvrage hydraulique, en contrepartie des services fournis.
Un retour progressif des déplacés
»Nous consommons parfois 600 litres de gasoil par jour. Nous utilisons 890 mètres cubes par jour. Le forage fonctionne de 5 heures à 14 heures, puis de 17 heures à une heure du matin », explique-t-il.
La construction de forages par le PUDC est une initiative naturellement très appréciée des populations, comme en témoigne Amadou Dia, âgé de 65 ans.
»Dans ce village, nous avons toujours été confrontés à une pénurie d’eau », dit le sexagénaire, qui a voyagé d’Aéré Lao à Louguéré Diabi en compagnie du reporter de l’APS.
»Dieu Merci. En 2023, le PUDC a construit ce forage pour nous. Nous en sommes contents et remercions l’État du Sénégal pour ce qu’il a fait à l’aide de ce programme », ajoute-t-il en présence d’autres éleveurs acquiesçant de la tête.

Selon Amadou Dia, avant la mise en service du forage de Louguéré Diabi, les éleveurs consacreraient une journée et demi, deux jours quelquefois, à la recherche du liquide précieux.
»On avait énormément de problèmes pour abreuver le bétail. Depuis que ce forage est là, les autres villages viennent ici chercher de l’eau. C’est aussi un grand soulagement pour les éleveurs transhumants », poursuit-il.
Au fil des années, la pénurie d’eau a engendré un phénomène migratoire. Certains habitants de Louguéré Diabi ont quitté le village à cause du manque d’eau, selon des témoins.
Un grand soulagement pour les éleveurs transhumants
Et depuis que l’accès à l’eau potable est devenu plus facile à Louguéré Diabi, les villageois notent le retour progressif de certains déplacés.
»Cette localité était très peuplée, mais beaucoup de nos frères ont quitté leurs concessions à cause du manque d’eau. Dieu merci, depuis que le forage est construit, nous assistons à un retour progressif de certains déplacés », se réjouit M. Dia.
La construction du forage est une aubaine pour les éleveurs transhumants venant de la zone du Djolof, à la recherche de pâturages. C’est le cas d’Abou Sow, éleveur transhumant dont le troupeau compte plus de 100 têtes.
Cet éleveur, trouvé avec ses bêtes à l’un des abreuvoirs du village, suivait son troupeau se bousculant pour étancher sa soif après des kilomètres parcourus sous la canicule. Le brise-jet du robinet laissait couler l’eau à flot, au grand bonheur du bétail qui en profite pour se désaltérer à grandes gorgées.

Abou Sow observe la scène, satisfait. »Sans eau, dit-il, aucun éleveur ne peut réussir. Je suis content, car mon troupeau s’abreuve bien. L’État doit construire davantage de forages et de châteaux d’eau dans la zone du Ferlo. »
Selon Amadou Dia, les 12 fontaines de l’ouvrage hydraulique approvisionnent au moins 5.000 bovins.
»Le nombre est important parce que les éleveurs transhumants nous viennent de partout, notamment du Djolof. Il y en a qui ont un troupeau de 100, 200, 300, voire 500 bovins », raconte-t-il dans un wolof approximatif et enrobé dans un accent pulaar.
Trois personnes meurent en allant puiser de l’eau
Avant d’en arriver là, le village de Louguéré Diabi a connu des histoires bien tristes liées au manque d’eau auquel il était confronté.
Il y a par exemple cette histoire concernant trois personnes, dont un garçon et une fille, qui ont perdu la vie alors qu’ils étaient en train de puiser de l’eau dans le seul puits qui comptait le village.
Depuis l’inauguration du forage, les habitants du village ont jugé nécessaire de fermer ce puits d’une profondeur de plus de 100 mètres.
Aïssata Dia, mère de l’une des victimes, a du mal à fermer la page de cette histoire bien traumatisante, que cette quinquagénaire, teint noir et taille moyenne, continue de ressasser.

»Ma fille avait 14 ans […] Malheureusement, elle est tombée dans le puits lorsqu’elle est allée chercher de l’eau », confie-t-elle au visiteur en pulaar, le regard figé sur la margelle du puits dont elle avait auparavant scruté la profondeur.
»Nous avons tellement souffert à cause du manque d’eau. Aujourd’hui, ce forage est un grand soulagement pour nous les femmes, nos enfants et le cheptel », ajoute Mme Dia sur un ton empreint d’émotion, le regard noir et plein de tristesse.
Faire de l’accès à l’eau en milieu rural une priorité
Mamadou Sara Ba, 63 ans, a lui aussi perdu son fils de 15 ans dans des circonstances similaires. Malgré le poids des années, le sexagénaire évoque avec émotion le film de la mort de son garçon. »Il tirait la corde du puits quand elle a lâché et l’a projeté au fond. Coincé pendant des heures à l’intérieur, mon fils a fini par perdre la vie », dit-il, d’une voix qui trahit la même tristesse lisible sur son visage.
Des confidences empreintes d’émotion, qui plongent l’assistance dans un silence profond. Un silence rompu par des troupeaux de caprins et d’ovins convergents vers Louguéré Diabi.

Ici, la pénurie d’eau a provoqué tellement de drames que chaque berger y va de sa mésaventure à raconter, des histoires malheureuses provoquées par l’augmentation des besoins d’approvisionnement en eau dans le Ferlo.
»On a connu beaucoup de difficultés. On parle des personnes décédées dans ce puits, parce que la vie humaine est sacrée. Mais ce puits est un cimetière de bétail », révèle un autre habitant du village.
»On ne peut pas compter le nombre de bovins, de chèvres ou de moutons tombés dans ce puits […] C’était une situation extrêmement délicate », rappelle le vieux berger.
Amadou Dia confirme son témoignage. »C’est vrai. On perdait notre bétail à cause du manque d’eau. Il y a deux ans, un de nos voisins a perdu deux bovins », dit-il.
Les habitants de Louguéré Diabi, conscients de ce passé douloureux, se réjouissent de la construction du forage, tout en invitant les pouvoirs publics à faire de l’accès à l’eau en milieu rural une priorité.
Ils considèrent que, de cette manière, l’État va développer l’élevage dans le Ferlo, une vaste région comprenant une partie des régions de Saint-Louis et Louga, ainsi que toute la région de Matam (nord). Cette perspective devrait également faire renaître l’espoir chez les éleveurs, les populations de manière globale.
ABD/ABB/BK/ASG/ESF


























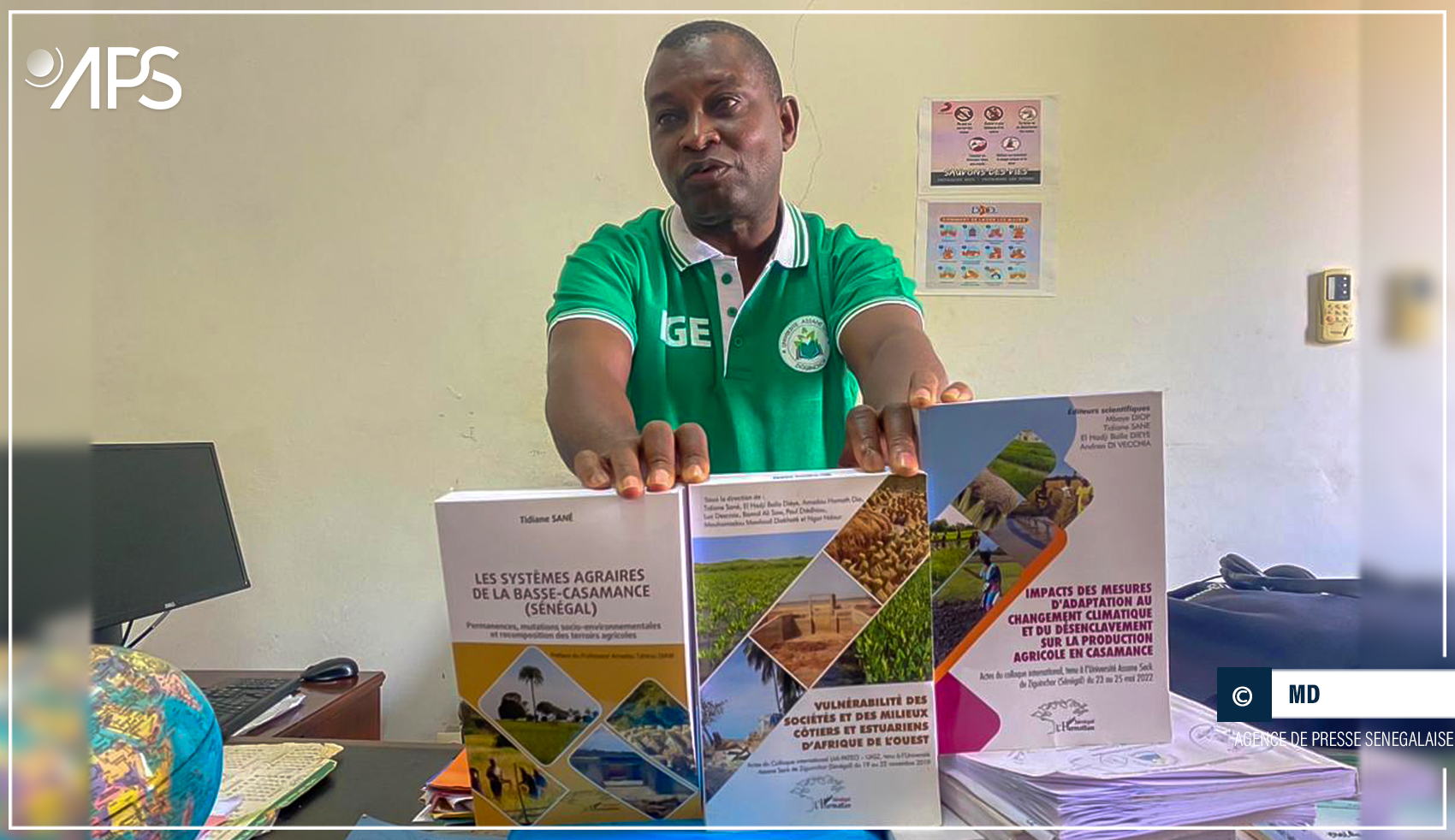



 ADI/BK
ADI/BK














